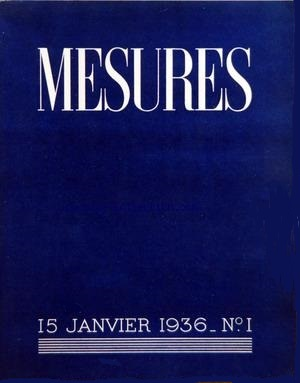
La demoiselle aux miroirs
Jean PaulhanIl est des solutions plus étranges que les problèmes. Car le problème du moins n'était qu'une question ; mais la solution en pose mille. Et certes nous avons trouvé la raison du paradoxe littéraire 1 : c'est que le terroriste est lui-même cet esprit pur, infiniment libre de langage, qu'appelait le rhétoriqueur. Par où Terreur et Rhétorique sont toutes deux fondées — l'une à dire ce qu'elle dit, l'autre à être ce qu'elle est. Il demeure une curieuse difficulté.
Je puis bien admettre, avec le sens commun, que l'hésitation entre tels et tels mots, l'oscillation, le retour et la pesée indéfinie, trahissent le jeu d'une pensée plus pure de langage qu'à l'ordinaire, puisqu'elle n'a pas encore trouvé mais cherche son expression : une pensée avant les mots, s'il en est. Avec la même évidence, je sais ce que pense cet homme à la croisée des chemins qui va et vient, et tantôt fait choix de la route de droite et tantôt de la gauche ; ou cet autre qui, au bout du précipice et déjà entraîné, hésite entre deux touffes d'herbe où se retenir. Cette évidence a pourtant une autre face : une face d'ombre et de paradoxe.
C'est qu'il nous a fallu supposer la pensée du terroriste. Nous l'avons déduite de ses divers propos. Nous n'y assistons pas. Bien plus, il semble que le terroriste lui-même demeure impuissant à la cerner, à la connaître (car il s'obstine dans sa prétention). Et qu'est-ce, après tout, qu'une pensée en nous dont nous n'aurions pas conscience, sinon une simple nuée ? Il semble en vérité que nous nous soyons bornés à substituer à l'ancien un nouveau paradoxe, et à déplacer la difficulté plus qu'à la résoudre.
I. MACHIAVÉLISME DE LA RHÉTORIQUE
La Société disait de Madame Camoin que son prestige tenait à la contradiction où elle jetait également amis et adversaires, tantôt occupés à lui faire grief de sa douceur excessive et tantôt de sa férocité, de son entêtement ou de sa nonchalance — ainsi contraints, pour finir, de lui reconnaître quelque secret qui passât douceur et violence, négligence et volonté. Et Chesterton dit du christianisme, dans le même sens, qu'après lui avoir reproché d'être trop optimiste — mais aussi bien trop désespéré ; trop tendre — mais aussi trop brutal ; trop détaché — mais aussi trop pratique, ses ennemis devraient enfin avouer qu'il est bien plutôt ce qui pousse à bout la violence comme la douceur, l'optimisme comme le pessimisme, et leur donne leurs couleurs franches.
Ainsi faudrait-il dire de la Rhétorique qu'elle tient sa vertu de la masse confuse d'objections qu'elle fait lever. “J'écris sans ordre, dit l'un, et comme les choses me viennent ; ordonner l'émotion, c'est la perdre. — Je m'applique à écrire sans ordre, dit l'autre : le premier jet n'est que convention.” Ainsi l'on refuse la Rhétorique, ici, parce qu'elle est artificielle, et là, parce qu'elle est naturelle. “C'est pure contorsion, et l'esprit s'y gauchit. — C'est naïveté pure, l'esprit y suit sa vieille pente.”
D'objections, mais tout aussi bien de louanges. “Je plie à des règles fixes, dit l'un, la fuite incessante de ma pensée. Je lui donne ainsi une origine et une fin — une existence.” Mais l'autre : “Je rends à mon esprit, par la règle, son rythme et son poids naturels.” Ainsi loue-t-on également la Rhétorique, comme on la blâmait tout à l'heure, de ce qu'elle est nature et de ce qu'elle est artifice, de ce qu'elle convient à l'esprit et de ce qu'elle s'oppose à lui.
Mais à qui tient compte à la fois de l'un et l'autre éloge, de l'un et l'autre blâme, plutôt semblerait-il que la Rhétorique possède un secret qui passe l'artifice et la nature, la phrase concertée et la phrase jaillie. En bref, l'on ne peut faire à son propos nulle remarque, qui n'entre dans son plan.
Je ne cherche, avant de l'aborder franchement, qu'à vulgariser le problème rhétorique. Il nous arrive de dire que tel sentiment est devenu vrai parce qu'on l'avait cru. Mais de la Rhétorique, à l'inverse, il faudrait dire qu'elle devient vraie dans la mesure où on ne la croit pas : à la faveur de ces tâtonnements autour d'elle, et de ces divers refus. Et l'on ne peut en dire non plus qu'elle plaide le faux pour savoir le vrai. Mais, plus exactement, qu'elle feint de plaider le faux pour provoquer le vrai. “Elle me reprocha, dit Rousseau, d'être trop hardi, pour me donner à entendre que je pouvais l'être davantage.” Ainsi fait la Rhétorique, à la façon des courtisanes. Comme s'il n'était nulle combinaison langagière, à quoi l'esprit ne dût répondre par de nouvelles inventions.
*
C'est un lieu commun de droit qu'il ne suffit pas de forger de nouvelles lois pour empêcher les querelles et les guerres ; tout au contraire les obscurités se multiplient par les commentaires que l'on en donne et les difficultés croissent à mesure qu'on les prévoit. Car les commentaires et la prévision engendrent à leur tour de nouveaux procès qui s'ajoutent aux autres. Ainsi en va-t-il de la Rhétorique, si elle n'offre nulle règle qui ne prête à réflexions contraires. Un tyran, s'il s'intéressait aux procès pour eux-mêmes, aurait tout intérêt à multiplier les lois. Mais qui ne s'intéresse aux Lettres pour elles ? Il faudra donc y multiplier les préceptes, les conventions, les unités. Certains sujets seront interdits. Le romancier (par exemple) aura le droit de traiter d'amour — mais non d'argent. Le dramaturge, d'amitié, et de sentiments familiaux, mais sous aucun prétexte de rêveries ou de santé. Certains tours de style, certaines figures seront permises, et les autres défendues. Les combinaisons rythmiques les plus subtiles y seront de mise. Comme deux hommes qui se servent d'une même langue y perdent moins leur âme particulière qu'ils ne la révèlent et en quelque sorte l'accouchent, ainsi de deux auteurs qui parlent par sujets et thèmes choisis : Phèdre distingue Racine de Pradon ; Amphitryon, Molière de Plaute. Si la Rhétorique a jamais été inventée, ç'a été sans doute pour mettre en lumière la personnalité des écrivains. Si elle a recommandé (avec une si douce insistance) de ne point chercher à être personnel, c'était pour mieux observer dans quelle mesure on ne pouvait éviter de l'être. Enfin elle a obstinément invité chaque écrivain à ”danser dans les chaînes”.
Encore ne faut-il pas que cette image nous abuse. Il se peut bien qu'il soit exaltant de danser dans les chaînes. Je n'ai jamais vu personne y parvenir (ou c'est que les chaînes étaient fausses) ; et de l'écrivain même, si je dois enfin admettre que la règle le sert et l'exalte, j'ai peine à imaginer par quelles voies. Or tant que je demeure ici incertain, la Rhétorique m'est incompréhensible — à la merci du premier argument venu. Voici du plus grossier. Pascal fait grief aux poètes d'avoir inventé certains termes bizarres qu'ils appellent beauté poétique : ce sont siècle d'or, merveille de nos jours, lèvres de rose. “Mais (ajoute-t-il) qui s'imaginera une femme sur ce modèle-là qui consiste à dire de petites choses avec de grands mots verra une jolie demoiselle de village, toute pleine de miroirs...” Il est trop aisé à Voltaire ou à Dacier de répondre là-dessus que lèvres de rose ou siècle d'or ne sont point “grands mots” ni phrases contraintes, mais l'expression naïve d'une surprise et d'un ravissement. D'où l'on conclura à notre tour qu'à lèvres de rose doit répondre enfin la pensée la plus pure, à la croisée de deux langages, et celle qui permet à la fois l'opinion de Pascal et celle de Voltaire. Mais je voudrais mieux voir cette pensée.
Au fait, nous voici rejetés à notre première difficulté. Je ne l'aborderai pas de face. Mais je tenterai d'abord de lui rendre, par des exemples voisins, son ampleur et sa portée.
*
Qui sait au juste ce qu'il pense ? Phédon croit détester Junie, c'est le début d'un grand amour. Hermas se juge indifférent à Lélie : c'est qu'il lui est bien trop sensible. Claude se croyait reconnaissant à Celse, qui l'a sauvé ; mais il se réjouit d'une mort qui emporte à la fois Celse et la reconnaissance. Les morales admettent volontiers que le cœur s'apprend, comme une langue.
Il est une forme aiguë de l'erreur. Nous traitons à tout instant de sentiments tels qu'il nous est impossible, ou difficile du moins, de les observer sur nous. On s'est moqué du prédicateur qui disait : “Pour la modestie, je ne crains personne.” Mais il faut dégager le paradoxe, que cache la raillerie : c'est qu'il est contradictoire d'être modeste, et de savoir qu'on est modeste. Car la modestie consiste à se diminuer soi-même. Mais si vous savez que vous vous diminuez vous savez aussi que vous êtes en réalité plus grand qu'il ne vous semble. Vous cessez donc d'être modeste. Ainsi en va-t-il, à l'inverse, de l'orgueil. On peut dire en gros qu'il consiste à se donner de l'importance. Or si vous voyez que vous exagérez votre importance, vous cessez donc de l'exagérer. Se voir orgueilleux est le fait de la modestie ; se voir modeste, de l'orgueil.
Ainsi de bien d'autres états d'âme, et des pensées. La bonté, le dévouement consistent à faire ceci ou cela — et à ne pas savoir que l'on est bon ou dévoué. Si le héros découvre son courage et la gravité du danger qui le menace, il cesse aussitôt d'être un héros pour devenir un suicide. L'espace, le temps, la civilisation nous sont des idées claires tant que nous n'y regardons pas de trop près : mais sitôt évoquées, les voici qui se brouillent et s'obscurcissent — inexprimables sitôt que l'on tente de les exprimer, insaisissables, de les saisir. Et loin que l'état rhétorique enfin fasse exception, bien plutôt faudra-t-il dire qu'il suit ici le sort de toute pensée.
Reste que ce sort offre ici quelque trait plus bizarre qu'il n'est courant, et à quoi nous nous sentons moins résignés. C'est que le courage, le temps ou la modestie étaient sans prétention : simples idées ou sentiments, qu'il est trop naturel de voir troublés par notre attention. Mais la Rhétorique nous avait fait une promesse, qu'elle ne tient pas. Elle devait, à l'entendre, nous révéler l'esprit authentique, la pensée pure. Quoi, si elle bronche à son premier pas sur un obstacle banal.
II. NOUS N'ASSISTONS PAS À NOTRE PENSÉE SANS L'ALTÉRER
Il est curieux que l'inconscient, tel que nous le dépeignent psychologues et psychanalystes, ne soit à l'ordinaire qu'un inconscient d'occasion. Il s'agit de pensées, de soucis, de hantises, qui tout aussi bien seraient conscients si quelque tabou social ne venait se mettre à la traverse : lois, convenances, scrupules.
Mais nous voici contraints de supposer, à l'inverse, un inconscient de nature. Au fait, la remarque la plus simple — mais la plus évidente — eût dû nous y mener du premier coup.
C'est que la pensée seule nous peut donner à connaître la pensée. Avoir conscience de quelque idée, souci ou sentiment que ce soit, c'est d'abord prélever sur eux la part de pensée nécessaire à notre regard. Nous ne les voyons jamais purs ; nous ne réfléchissons jamais — la réflexion étant aussi pensée — qu'une pensée diminuée de cette réflexion. L'homme ne saisit pas plus son esprit intact qu'il ne voit directement sa nuque ou son cou. Encore y a-t-il des glaces pour le cou et la nuque. Il n'y en a pas pour l'esprit. Il se peut que la pensée originelle ait ses pouvoirs inconnus, ses liaisons mystérieuses, son extrême liberté. Mais les hommes n'en savent rien — je ne dis pas seulement les psychologues et philosophes (qui semblent s'être donné à tâche de nous rassurer là-dessus) mais le premier venu, l'homme de la rue, vous et moi. Et sans doute n'est-il pas d'angoisse plus lancinante que celle qui tient à cette ignorance, si j'en juge par les contes et les mythes qu'elle agite. Elsa veut savoir qui est Lohengrin, et Lohengrin disparaît. Si Psyché voit l'Amour, l'Amour s'évanouit. Si la femme de Loth se retourne, elle devient une statue de sel ; Orphée regarde Eurydice, et Eurydice retourne aux Enfers. Les précautions n'y changent rien : si rapide que soit le regard, si léger le penchement de tête, tout est déjà accompli. Je laisse ces soucis plaisants, qui nous tiennent lieu de mythes : le chien qui court après sa queue, le chat qui veut attraper son ombre ; l'homme que hante le désir de se voir, ne fût-ce qu'une fois, comme s'il n'était pas lui — les légendes les plus naïves ou subtiles nous avertissent également que le plus proche de nous est le mieux caché. Chaque homme porte dans son secret, tant que dure sa vie, l'amant invisible qui fut donné à Psyché.
*
Mais la légende porte aussi que nous ne nous résignons pas. Il nous demeure surprenant que le flambeau (comme disent les proverbes) n'éclaire pas sa base, que le regard ne puisse être saisi du regard, et que l'homme “connaisse tout, hors que lui-même”. Il nous est insupportable qu'Orphée ne puisse voir Eurydice. Et je veux bien que notre hantise d'un autre pays, d'un pays inconnu, ne fasse qu'exprimer à sa manière la préoccupation où nous sommes de notre pays inconnu, et le seul interdit. Mais qu'il nous soit à jamais interdit, cela du moins nous ne l'acceptons pas.
Ici, l'on peut imaginer plus d'une méthode et d'une enquête. Les plus “naturelles”, celles qui viennent d'abord à l'esprit, échouent : ni la hâte et l'extrême brusquerie, ni la négligence, l'absence ou l'effacement ne nous apprennent à l'épreuve rien qui passe notre pensée banale. Et bien plutôt semblerait-il que le rêve ou la rêverie, l'écriture automatique, le chant profond, le cri viennent encore accentuer les procédés communs de notre conscience : plus réfléchis que la raison, plus calculés que nos calculs, plus littéraires que la littérature, et toujours à la mode du temps. Faut-il s'en étonner : l'on ne voit point du tout pourquoi la pensée qui observe serait nécessairement plus rapide que la pensée observée ; ni la pensée secrète évidente, quand la pensée familière s'efface. On l'a dit : il n'est qu'une sorte de pensée, à laquelle notre désir d'une solution prête seul, suivant le cas, des qualités diverses ; et ce n'est pas pour tourner plus vite que le chien a plus de chances d'attraper sa queue.
Où la voie directe est inefficace, restent les voies indirectes. On a pu dire qu'il suffirait à l'homme, pour se connaître, de patiemment observer sa conduite et ses actes. Il se peut ; mais enfin je ne vois pas ce qu'une telle observation nous pourrait apprendre de neuf. Si même j'admets (ce qui n'est point prouvé, et ne me semble guère probable) que ma conduite ressemble à ma pensée profonde et la traduit plus exactement que ne fait ma réflexion, reste que c'est encore par réflexion que je saisis cette conduite. En sorte que la même déformation, dont je me défiais, va s'exercer ici — et d'autant plus librement qu'une première expression a toutes chances de lui laisser une pensée dont l'intégrité est déjà menacée, sinon à jamais compromise. L'on peut supposer ici une méthode plus efficace.
Il est un point au moins que nous ne pouvons éviter de tenir pour acquis : c'est que notre réflexion — puisqu'elle est au courant de notre pensée réelle, et de même nature qu'elle — du moins ne se trompe pas du tout au tout. C'est qu'elle saisit une part de la pensée originelle — privée de sa nuance propre et de son trait essentiel, il se peut ; déformée tant que l'on voudra. Mais enfin une part, et telle que l'on puisse à partir d'elle — si l'on parvenait à savoir en quoi consiste la déformation et quel est le trait dont la réflexion la prive — reconstituer la pensée primitive. Il y suffirait d'observer ailleurs le jeu propre de la réflexion et la nature de la déformation qu'elle entraîne. Ailleurs, je veux dire sur quelque pensée qu'il nous fût donné de saisir avant et après la réflexion, en sorte que cette déformation s'y trouvât redoublée. Or il suffit de poser le problème pour entrevoir une solution.
*
Il est un trait de toute traduction, auquel je ne sache pas que l'on ait jamais prêté une attention suffisante : c'est — à prendre les choses au plus simple — qu'elle exprime quelque sentiment ou pensée qui avait déjà reçu son expression. Alors même que le traducteur s'efforce d'oublier les mots du texte primitif pour n'en retenir que l'esprit, et si passionnément qu'il se veuille pénétré des impressions qu'il en reçoit, il ne peut qu'il en néglige tout à fait la lettre, et le lecteur attentif demeure libre à tout instant de confronter l'un à l'autre texte. Or cette confrontation prend à nos yeux un prix singulier.
Car s'il est un caractère propre de l'expression comme telle — et par exemple une certaine altération qu'elle apporte à la pensée — il faut donc admettre que l'altération se trouvera, dans le second texte, redoublée. Je laisse les chances d'erreur qui peuvent ici jouer. Je prends la traduction la plus stricte et la plus fidèle qui soit : elle devra présenter dans notre hypothèse, à proportion même de sa fidélité, une différence régulière d'avec le premier texte, qui sera la marque propre de l'expression. En sorte qu'il ne nous resterait plus — pour remonter du texte primitif à la pensée pure qu'il exprime — qu'à découvrir en lui et réduire une différence de même nature.
Et simplement aura-t-on soin de choisir une sorte de traductions où cette différence ait chance d'être nettement prononcée : soit qu'il s'agisse de deux langues de structure très différente, comme seraient une langue civilisée et une langue primitive ; soit d'une même langue, à deux moments de sa durée, à deux places de son usage, où le plus mince écart soit mis en valeur : ainsi du français courant, confronté à l'argot et au français du XVIe siècle.
Il suffit de poser la question pour lui trouver réponse : il n'est pas un essai de traduction du kikouyou ou du cherokee dans le français courant (et tout aussi bien l'anglais et l'allemand), de l'argot des bouchers ou des escarpes dans le français littéraire, et de la langue du XVIe siècle dans celle du XXe, qui ne nous donne à supposer, de l'une à l'autre langue, une différence de nature — si claire et si frappante qu'elle a pu faire l'objet de plus d'une étude fort grave : exactement la langue à traduire — argot, cherokee ou langue de Villon — nous paraît plus imagée à la fois et plus concrète que la langue où nous la traduisons.
III. D'UNE VOIE JUSQU'À LA PENSÉE AUTHENTIQUE
Victor Hugo disait que le français commun se borne à nommer les choses, mais que l'argot les montre. Il en donnait l'exemple, entre autres, de lancequiner (pleuvoir), où les gouttes de pluie, disait-il, sont heureusement comparées aux lances des lansquenets. Tête ne nous est qu'un mot abstrait, mais bille, boule, trognon, fiole, cafetière ou calebasse font image. Babillarde est plus expressif que lettre ; faire du boniment que gagner les bonnes grâces, etc.
Il faudrait citer ici bien d'autres langues que l'argot. On a longtemps admis, sur la foi de Diderot et Rousseau, que les peuples sauvages et les enfants usaient d'une langue toute poétique. On l'admet encore parfois. Quand la petite Jacqueline dit que les cygnes labourent l'eau et que son frère parle à tâtons, la famille est confuse d'admiration. Or les sillons de l'eau, la tête ou les bonnes grâces ne devraient pas moins nous paraître images, si l'habitude n'effaçait pour nous leur vivacité. La même habitude cependant cache à l'enfant ou à l'escarpe la métaphore dont il use : bille ou cafetière ne lui sont pas moins abstraits que notre tête ; babillarde, que notre lettre. Quant à lancequiner, c'est Hugo seul, emporté par l'illusion du traducteur, qui y découvre une métaphore. Le mot est un dérivé régulier d'ance 2 (eau). L'illusion peut prendre encore une autre forme. C'est que la langue primitive nous paraît plus concrète que nos langues. On a parlé volontiers, de tout temps, de la naïveté des vieux auteurs, de leur respect des moindres détails, de leur inhabileté à l'abstrait. Les explorateurs admirent, de leur côté, que le lapon ou le luganda n'ait point de mot pour renne, mais un mot particulier pour le renne d'un an, un autre pour le renne de deux ans, un pour le renne de trois ans, et ainsi de suite. Point de mot pour le bras, mais un mot pour le bras droit et un pour le bras gauche.
Il est facile de répondre que le français dit poule, poulet, poussin, coq, mais n'a pas de mot, comme le lapon, pour l'espèce à laquelle appartiennent ces divers animaux (ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'en forme pas l'idée abstraite). Que l'anglais distingue entre aimer Dieu et aimer les pommes de terre mais n'a point de mot (comme le malgache ou le français) qui serve aux deux sentiments. D'où suit assez bien que le luganda ou le lapon, à son tour victime de l'illusion retournée, verra dans le français ou l'anglais une langue concrète à l'excès. Mais l'erreur nous importe moins que l'illusion.
*
Il est curieux que l'esprit soit plus lent que la main ou que l'œil à se défaire de ses illusions naturelles. La tache noire que nous apercevons au loin n'est pas un grain de poussière ni un nain, mais un homme comme nous. Nous le savons : nous croyons voir un homme. Mais nous continuons d'admettre (et plus d'un livre sérieux n'a pas d'autre sujet) que l'argot et les langues lointaines sont imagés et concrets, mais notre propre langue fort abstraite. Si je cherche la raison d'une illusion constante, voici ce que je trouve : c'est que toute traduction, et plus elle est fidèle, a pour premier effet de dissocier les stéréotypes d'un texte. Elle rend leur indépendance aux éléments de sens que la première langue associait. Si je lis négligemment :
Beaux enfants vous perdez la plus
Belle rose de vos chapeaux 3
je puis avoir le sentiment vague de quelque perte ou déchéance, et m'en contenter. Si je suis un traducteur ou un commentateur minutieux, je rappellerai d'abord qu'il y eut une mode des chapeaux de fleurs, et jusque dans la société la plus grave. Partant de là, j'expliquerai que la plus belle rose du chapeau désigne ici, par métaphore, le bien le plus précieux. Voilà ma traduction assez bien faite pour donner le sentiment d'une langue à la fois imagée et concrète. Mais où sont l'image et le concret ? Dans cette traduction seule, et dans l'opération par quoi je rends à son sens détaillé une phrase à demi obscure. Le contemporain de Villon ne devait entendre qu'un lieu commun fort simple, et tel à peu près que serait pour nous : “Il a perdu la fleur de sa jeunesse, la fleur de ses ans.” Ainsi babillarde, bille, labourer, renne d'un an, bras droit ne donnent-ils non plus le sentiment du concret ou de l'image qu'au cours de l'opération qui les traduit. Mais c'est notre tête, notre sillon, nos coq et poules qui vont paraître au primitif, à l'enfant, à l'escarpe, images et détails concrets. C'est qu'ils doivent commencer par les détailler, et les imager, bâtissant à leur occasion toute une phrase et comme une petite fable.
Je ne rappelle ici rien qui ne soit aux traducteurs de pratique courante. Quand André Gide observe, des Mille nuits et une nuit, que la traduction de J.-C. Mardrus, infidèle sans doute à la pensée du conteur, nous restitue plus loin l'esprit même et l'imagination de la langue arabe 4 ; quand Paul Mazon note à propos des traductions de l'Iliade cette insurmontable difficulté : c'est qu'à traduire dans leur détail concret les formules homériques, l'on fausse le mouvement naturel du texte 5, ils ne font que mieux marquer la déformation inhérente à toute traduction — à laquelle il est enfin temps de chercher remède.
*
Que toute réflexion cependant agisse sur notre pensée originelle à la façon dont la traduction altère un texte, je n'en veux d'autre preuve que le consentement commun. On admet couramment que l'analyse décompose et pétrifie nos élans, notre émotion. Ainsi la femme de Loth devient sel, et pierre le visiteur de la Gorgone. Point de mythe ici qui ne nous montre sur l'âme dès que nous la regardons la dispersion et la glace. Et Paul Mazon parle de l'Iliade traduite à la façon dont les vieilles mythologies décrivent l'Amour, sitôt que Psyché l'a regardé. Seulement peut-être savons-nous à présent comment il serait possible d'éviter la glace, et la déformation.
Il y suffirait de rendre à la traduction — et tout aussi bien à l'esprit — les stéréotypes, les lieux, la disposition abstraite dont notre regard l'a privé. Car le problème qui se pose aux traducteurs n'est susceptible de recevoir qu'une solution : ce n'est pas, bien entendu, de substituer aux clichés du texte primitif de simples mots abstraits (car l'aisance et la nuance particulière de la formule s'y perdent) ; et ce n'est pas non plus de traduire mot à mot le cliché (car l'on ajoute ainsi au texte une métaphore qu'il ne comportait pas) ; mais il y faut obtenir du lecteur qu'il sache entendre en cliché la traduction comme avait dû l'entendre le lecteur, l'auditeur primitif, et à tout instant revenir de l'image ou du détail concret, loin de s'y attarder.
La chose exige, je le sais, une certaine éducation du lecteur, de l'auteur lui-même. Peut-être n'est-ce pas trop exiger de l'homme, si cet effort est aussi celui qui lui permettra de remonter de la pensée immédiate jusqu'à la pensée authentique. Si ce n'est point seulement sur l'Iliade qu'elle va nous renseigner exactement, mais sur ce texte plus secret, que chacun de nous porte en soi. On a reconnu, au passage, le traitement rhétorique.
Il nous arrive de dire, à la légère, que les règles relèvent du pur arbitraire des rhéteurs et des grammairiens et que l'on ne voit point du tout à quelle nécessité de la pensée pourraient répondre la rime ou le nombre des pieds. Mais si c'est au contraire la pensée donnée qui porte, du fait même de ce don et de notre regard, tous les signes de l'arbitraire et du faux, il faut d'abord reconnaître au rythme, à la rime et aux pieds cette valeur et ce mérite singuliers : c'est qu'en rendant à l'esprit les stéréotypes et les lieux dont notre attention le privait, ils le restituent à son état premier, et nous à notre condition de fils du soleil.
*
* *
Il nous est arrivé une aventure singulière : comme si le problème que nous commencions par poser, loin de se voir résolu par la suite, s'était en quelque façon renversé. Ce nous était d'abord une sorte de scandale de la raison que la rhétorique ne prit sa valeur que par référence à un esprit inconscient — réel, je le veux bien, et dont nous observions les effets, mais tel enfin qu'il échappât à notre prise.
Or cet esprit n'a pas cessé de nous échapper. Notre découverte a porté ailleurs : en bref, ce n'est pas du tout parce que la pensée rhétorique était anormale et artificielle que nous demeurions impuissants à nous la figurer, c'est parce qu'elle était un peu trop normale et naturelle — j'entends trop près de la nature et de ces pensées originelles dont nos idées et nos sentiments, sitôt que nous les distinguons, ne sont plus qu'un écho déformé.
Je n'ai pas dit que la découverte fût rare, ou le moins du monde inattendue. Somme toute, elle ne fait guère que justifier l'impression qui venait à tout instant nous tourmenter. Et qu'eût pu signifier d'autre le souci, commun aux rhétoriqueurs, d'un esprit un peu plus spirituel qu'à l'ordinaire ? C'était bien à l'endroit de la Rhétorique, que le paradoxe de la réflexion nous semblait particulièrement intolérable. Enfin, qui ne sait d'expérience qu'il est plus d'un poème et d'un vers où l'éternel, l'immédiat, l'intime et le propre à tous comme le jour et la nuit, l'espace et le temps, se reflètent comme en un miroir — l'un de ces miroirs dont on pare la jolie demoiselle de campagne.
1 - cf. Mesures, 15 janvier, La rhétorique renaît de ses cendres. ↩
2 - D'où vient l'ance, ou lance (cf. hedera-lierre) et suffixe quin, quine (cf. rouquin, etc). ↩
3 - Villon ↩
4 - Quelques livres, Œuvres, t. III. ↩
5 - Madame Dacier et les traductions d'Homère. ↩
Texte paru dans la revue Mesures, 15 avril 1938 - N°2.