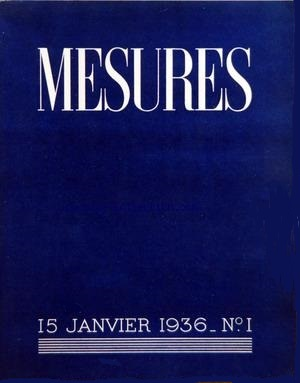
La rhétorique renaît de ses cendres
Jean PaulhanL'on voit d'abord à tout problème de style je ne sais quelle allure médiocre ou basse — et nous nous hâtons de le rejeter. Qui s'arrête à mon langage, disait Montaigne, j'aimerais mieux qu'il se tût. “Je ne suis pas écrivain”, dit l'écrivain. Nous voici joyeusement renvoyés à l'amour, à la force et à la peur, aux choses du monde.
Or nous ne pouvons cependant éviter qu'elles ne nous renvoient assez vite au langage. Car le tout-venant de l'esprit se montre, à l'usage, plein d'artifice et d'apparente fausseté. Des événements divers, qu'enchaîne un roman, il en est un qui nous paraît invraisemblable : c'est celui qui s'est passé ; et des personnages, le plus vrai ; des dialogues, le plus exact. Un sûr moyen de ne convertir personne est d'exposer, comme elle nous vient, notre pensée, notre émotion. Rien ne fait littéraire, en lettres, comme l'authentique.
Qui revient au problème rhétorique s'aperçoit, à sa surprise, que rien n'est si rigoureux ni si grave ; qu'il s'y doit engager tout entier, s'il veut seulement le comprendre, et qu'il n'est guère ici de solution qui n'ait l'allure et la nature d'un serment. S'il rappelle alors son premier dégoût, il y reconnaît l'effet de sa faiblesse, et de cette lâcheté commune qui nous détourne d'une tâche un peu trop difficile et nous la montre chimérique ou basse. Mais lui n'a rien de plus pressé maintenant que de mordre à ces raisins verts.
Il se porte, pour commencer, au cœur du problème.
I. LE PARADOXE LITTÉRAIRE.
Le monde moderne a curieusement renoncé à la rhétorique pour la même raison qui avait fait la rhétorique. Si les règles et les genres ont jamais été imaginés, c'était pour assurer à l'esprit humain sa pleine liberté, pour lui permettre les cris, et la surprise, et le chant profond ; et c'est aussi pour assurer ce chant et ces surprises que nous rejetons aujourd'hui les règles et cherchons à confondre les genres. Si l'homme a inventé le discours en trois points ou la tragédie en cinq actes, c'était pour éviter à jamais l'artifice ; et c'est aussi pour éviter l'artifice que nous fuyons aujourd'hui les trois points ou les cinq actes. En bref la rhétorique, à l'entendre, ne s'est jamais proposé que d'arracher l'écrivain aux conventions et aux phrases : de le rendre au naturel, à la vérité. Mais il nous semble plutôt qu'elle n'a jamais formé que des faiseurs de phrases, et des arrangeurs de mots. D'où suivent ici l'originalité, la révolte et la Terreur ; là l'obéissance, l'imitation, le respect des règles. Le paradoxe littéraire est plus étrange encore :
c'est que les preuves et les arguments de la Terreur sont aussi ceux de la Rhétorique. On songe à quelque personne célèbre, que les uns jugeraient trop maigre, les autres trop grasse. Ce serait peu : sur le même portrait. Mieux encore : sur les mêmes traits de ce portrait, sur la même ligne de la joue, de la hanche. Car la Rhétorique prétend libérer l'esprit de l'empire du langage — et la meilleure preuve qu'elle donne de son succès est l'usage qu'elle fait des règles et des lieux communs. Mais une anti-rhétorique ne veut, à son tour, que libérer l'esprit de ses chaînes de mots. Elle nomme ces chaînes : ce sont aussi les lieux communs et les règles.
Or ce ne peut être l'un et l'autre à la fois. Si le cliché libère l'âme, il ne peut en même temps l'asservir ; si la règle soumet le langage à la pensée, elle ne peut en même temps plier la pensée au langage — à moins d'être d'une nature si étrange qu'il faudrait alors laisser, pour la pénétrer, tout autre souci. L'on dit parfois qu'il est arrivé aux hommes, et aux écrivains en particulier, de changer de goût. Mais il semblerait plutôt que tout change dans le monde, hors le goût de l'homme et de l'écrivain.
*
Tel est le paradoxe central des Lettres. L'on marquera, avant de s'en prendre à sa difficulté, ce qu'il offre à la base de naïf et d'évident. De vrai ne fait-il appel qu'à notre expérience banale, comme si les Lettres puisaient à tout instant leur matière et leur raison dans cette expérience, dont elles ne seraient qu'un état plus pur, et plus précis.
L'on pourrait dire de la conversation et de la réflexion courantes que le langage ne s'y montre pas tout à fait distinct de la pensée. Mais les deux confondent leur train ; nous y parlons notre pensée, nous y pensons notre langage. “Comment allez-vous ?... Je n'aime pas ces froids. Il va encore faire plus froid, les hirondelles sont déjà parties...” Il n'est que d'entrer dans le courant du bavardage pour éprouver qu'il ne s'y agit pas particulièrement de mots, ni de pensée. Les deux vont de conserve.
Non que le départ ne demeure à tout moment possible. Il y suffit d'une hésitation, d'un retour, d'une question qui n'est jamais tout à fait obscure : “Les hirondelles, vous voulez dire les martinets ?... Puisque vous vous intéressez à ma santé...” Ou : “Le mot dont vous vous êtes servi... si vos mots avaient dépassé votre intention ?...” Aussitôt la confusion se dissipe, et nous accordons qu'il y avait, en effet, mots et pensée. De l'une aux autres, tous les rapports possibles : la fidélité et la trahison, le vague et le resserré, la nonchalance et la précision. L'engagement, le dégagement dont traitent Terreur et Rhétorique ne sont que l'un de ces rapports, non le moins familier.
Il arrive à tout instant qu'un mot nous manque, et nous le recherchons, essayant l'un après l'autre dix mots voisins, que sépare quelque nuance légère de sens : celui-ci nous paraît trop pesant, celui-là trop libre, et cet autre prétentieux. Tantôt il arrive que le terme oublié nous revienne enfin, et nous le reconnaissons ; tantôt il semble qu'il n'existe pas, et nous demeurons suspendus — mais d'autant plus vivement rejetés vers notre seule pensée — entre plusieurs mots, dont chacun nous semble injuste ou grossier. (Ainsi des rêves, lorsque nous tentons de les raconter, sans grand succès).
Je ne cherche qu'à retrouver patiemment le milieu banal où jouent Terreur et Rhétorique : il nous paraît, en de tels cas, que chaque mot risque de nous engager un peu plus loin que nous ne le voudrions. Maître du mot que tu vas dire, esclave du mot que tu as dit. Aussi bien ne manquons-nous pas d'excuses, dès qu'il s'agit d'échapper à l'esclavage : “Le mot a dépassé ma pensée... ne l'entendez pas à la lettre... ce n'était qu'une façon de parler...” et le reste.
*
L'on observera là-dessus que Terreur et Rhétorique s'accordent encore sur deux points. L'un serait que les règles et les lieux communs semblent particulièrement propres à provoquer cette dissociation du mot et de l'idée : ou du moins à la précipiter — et comme les catalyseurs de cette analyse. Puisque c'est, en tout cas, à leur propos que la question se pose, et les réponses opposées sont fournies.
Le second point serait que les réponses s'inspirent toutes deux du même principe ; c'est (pour le dire en gros) que la pensée vaut mieux que le langage : qu'il faut s'en rapporter à elle en dernier ressort. Mais l'on appelle son choix, l'on sollicite sa décision, comme s'il n'était pire humiliation que d'obéir au langage.
Somme toute, le parti pris est acceptable. Il n'est pas sans rappeler, par son autorité et son évidence, cet autre parti pris, purement moral, qui retrace les luttes du corps et de l'esprit, et exige enfin la soumission du corps. Ainsi du langage, ce corps de la pensée.
Reste qu'un tel parti-pris à son tour se puisse exprimer par deux doctrines, à tel point contradictoires. Nous voici revenus au paradoxe. Simplement faut-il observer encore que la Terreur offre à son examen un terrain plus favorable que la Rhétorique.
Car celle-ci se borne à aligner ses règles et ses principes, comme s'ils allaient de soi. Voici la métaphore et l'hypallage, dit-elle, voici les lieux. Elle ajoute (comme avec négligence) qu'ainsi l'élève parvient à la vérité, au plus pur de l'esprit. Mais la Terreur à l'inverse part d'une vue de la rhétorique : exactement, de la considération des défauts de la rhétorique, de ses erreurs, de ses pièges. Il serait peu de dire que la Terreur connaît la Rhétorique : elle procède d'elle et la suit pas à pas ; elle n'en finit pas de la connaître, et de la réfuter. Il n'est aucune pièce du procès qu'elle n'étale et ne discute devant nous.
II. LA RHÉTORIQUE BATTUE EN BRÈCHE.
J'imagine donc que nous voici jetés en pleine rhétorique : soumis aux règles et aux genres, tenus à telle et telle figure de langage, à telle sorte de phrases ou de mots : la métaphore, le vers régulier, le mot poétique. Toutes expressions soumises elles-mêmes aux lieux qu'il s'agit de rendre : la comparaison, la fin, le moyen, la brièveté des beaux jours, la vulgarité de la foule.
C'est à cette soumission que s'en prend la Terreur. Il lui suffit bien, pour fonder son attaque, des aveux de la Rhétorique.
L'on a tout dit des méfaits de la rime, ou de la métaphore. Quoi ! Le poète se devrait arrêter en pleine inspiration, pour céder à un son, un bruit, une forme creuse, et mettre trois mots où il en pensait deux ? Et comment sa passion, sa pensée y resteraient-elles authentiques ? Les voici tordues, contrefaites, et ne laissant enfin venir jusqu'à nous qu'un faux, où la ruse de l'écrivain se confond à l'émotion de l'homme. Trop heureux si l'humiliation demeurait secrète et que le faux eût la figure du vrai. Mais nul ne s'y trompe ; le drame a un acte de trop, le vers est plein de bourre :
Sire, je parle franc et je ne farde guère
D'ailleurs nous n'avons pas de machines de guerre 1
et les lieux du discours se suivent à la parade :
La vertu, placée au principe de l'homme, tient heureusement le milieu entre les vices extrêmes et nous prépare par son action lénifiante à la fin éternelle... 2
Et même si l'on se trompe, quelle honte n'en demeure-t-il pas au poète ou à l'orateur, contraint par je ne sais quel arbitraire à découper et tailler dans son ivresse et son transport, ou les gonfler au contraire jusqu'à la mesure d'une machine de langage préméditée. Mais l'on a tout dit sur la lutte de l'ange contre l'esthète, du litre contre l'amphore, de la poésie contre la beauté. Si l'on aime mieux, du jeune romantique contre le classique vieilli.
Car l'objection est ancienne. Et la réponse — si du moins l'on ne veut pas abandonner le poète à son mensonge et à ses faux — non moins ancienne. (Cependant, si naturelles toutes deux, que l'on ne songe guère à leur âge).
*
“Je ne l'ai pas voulu, dit le classique. Il m'arrive certes de chercher à tâtons. Ce n'est pas toujours pour trouver le lieu, ou la rime. Et bien souvent ce qui vous paraît, dans mes vers, artifice ou labeur, est ce qui m'est venu des dieux. Il est fréquent que la rime me parvienne avant l'idée, ou du moins toute confondue à elle, et les mots à mon émotion. Pensée et langage me sont tout un. Et comme vous parlez à tout instant d'arbre ou de ciel sans avoir la moindre conscience d'user du mot arbre, ou ciel, ainsi en va-t-il pour moi du mètre et de l'assonance. La rime est de ma grammaire ; la métaphore, de ma syntaxe.”
Ainsi parle le rhétoriqueur. A qui lui oppose qu'il ne s'agit pas là d'une expérience commune, il peut bien répliquer qu'il ne serait pas poète, s'il était lui-même tout à fait commun : qu'au surplus le terroriste a lui aussi ses mots clefs et ses rimes ; et qu'il en use simplement, pour s'être refusé à les reconnaître, sans aucun tact. Victor Hugo se vante, en plus d'un endroit, d'avoir massacré la rhétorique et fait frémir l'hypallage. Mais ses poèmes abondent en battoirs vertueux, en gerbes généreuses, en lins candides, en herses fidèles ; Delille était plus discret.
Le terroriste a sa réplique toute prête. “Soit, dit-il. Ai-je prétendu que nous étions parfaits ? Simplement votre esclavage et parfois le nôtre remontent si loin que nous ne les distinguons plus. Mais en est-on moins serf, pour ignorer sa servitude ? L'on vous a rompu, dès l'enfance, à ces vaines figures sonores. Vous avez appris, comme une autre langue, règles et lieux, tropes et mœurs. S'ils vous sont aujourd'hui naturels, en étaient-ils moins habitude ? Spontanés, en étaient-ils moins convention ? Votre cas est plus grave encore que je ne pensais. Car la technique et l'artifice vous eussent laissé du moins quelque liberté d'esprit, et le sentiment de votre déchéance. Mais vous êtes vous-même passé rhétorique et langage.”
Ainsi voit-on chaque argument de la rhétorique retourné contre elle. Le lieu est-il fabriqué, c'est que l'esprit accepte de se plier au langage ; spontané, c'est qu'il s'y est plié une fois pour toutes. Et la présence enfin de la règle ou du lieu ne trahit en tout cas que servitude et que soumission.
*
Telles, les raisons de la Terreur. Il faut avouer qu'elles semblent pressantes. Au demeurant, si faciles, si aisément évoquées, qu'il faudrait s'étonner peut-être que la Rhétorique leur ait longtemps survécu. (Car l'on n'a pas attendu Victor Hugo pour les inventer. Mais Platon et Montaigne, mais Pascal et Diderot ne cessent de les opposer aux habiles de leur temps, et aux éloquents). Simplement faudrait-il se demander si elles ne sont pas un peu trop faciles. Il est de ces doctrines que rien n'embarrasse : ce ne sont pas toujours les plus sûres, ni les mieux fondées. Puis, je vois trop jusqu'où l'on devrait prolonger celle-là : jusqu'à soutenir que toute syntaxe trahit l'esprit, et tout langage nous ment ; car s'il est concerté, c'est artifice ; et servitude, s'il est spontané. (Mais il se peut après tout, je n'en sais rien, qu'il faille renoncer au langage). Il y a plus grave.
C'est qu'il est aisé de renverser les raisons de la Terreur, employant le même ressort d'argument à défendre les mots, les règles ou les lieux. S'ils sont naturels (dira-t-on), c'est donc que l'esprit s'y donne libre jeu : c'est que la règle a cessé de lui être opaque et langagière ; mais il l'a dépassée pour retrouver ses propres lois. — Il arrive que vous les recherchiez. — Soit. Je ne les emploie du moins qu'une fois gagnées à l'esprit quand leurs mots ne me sont plus sensibles, mais leur seule face de pensée...
Il n'est que trop facile de retourner ainsi contre elle chaque argument de la Terreur : le lieu commun est-il spontané, c'est autant de gagné sur le langage. Réfléchi, l'on assiste à la victoire de l'esprit.
L'on connaît ce tour de cartes où le sujet se voit conduit à désigner la carte dont l'illusionniste a fait choix. (C'est, par exemple, le sept de carreau). “Prenez-vous les rouges ou les noires ? — Les noires. — Bien. Il nous reste les rouges. Cœurs ou carreaux ? — Les carreaux. — Bon, dans les carreaux, les figures ou les cartes basses ? — Les figures. — Je vous les rends. Et dans nos cartes basses...”
Il arrive que la ruse réussisse. Or le tour qui nous occupe est à peine plus subtil. Et simplement apparaît-il que le terroriste et le rhétoriqueur, ayant d'abord fait choix du langage ou de la pensée, conviennent d'entendre suivant ce parti pris tout exemple qui les occupe. (Aussi bien n'est-il point d'expression qui n'ait son langage et sa pensée). Il les faut renvoyer dos à dos.
III. OÙ LA RHÉTORIQUE FAIT DE SON DÉFAUT VERTU.
Si creux ou médiocre que soit l'argument de la Terreur, si naïve sa prétention, reste qu'il se produit. Ce n'est pas assez dire : il se produit couramment. A défaut de preuve, il est un état d'esprit. A qui n'est-il arrivé de se dire, devant un discours électoral, un boniment de camelot : “Ce ne sont là que des phrases qu'il aligne... est-ce qu'il croit m'avoir avec ses slogans ?” Quitte à penser, l'instant d'après : “Bah, il les a déjà dits souvent... Il se peut bien qu'il ait fini par y croire... Il ne voit même plus que c'est des mots.” Se portant ainsi sans effort de l'une à l'autre position de l'argument, comme si elles ne lui étaient qu'une seule pensée dont il découvrirait successivement les deux faces.
Or nous savons encore de cette pensée qu'elle joue régulièrement à l'endroit de la rhétorique ; qu'elle en est la suite, et comme le second temps. On a dit de la Terreur qu'elle comprenait la rhétorique. Mais quand le rhéteur dit, et répète, qu'il faut éviter de laisser le compas dans le cercle, ou le mètre dans le mur, et que la véritable rhétorique commence au dégoût de la rhétorique (comme la philosophie à la haine de la philosophie), que fait-il, que prévoir à son tour, et déjà comprendre la Terreur. Si Montaigne connaît Cicéron, Cicéron s'attend à Montaigne.
Nous voici portés insensiblement jusqu'à un nouveau problème qui traiterait moins de la valeur que de la nature de la Terreur. Ce ne serait plus : “Que veut le terroriste ?” mais : “Que pense-t-il ?” Ni : “Que peut être la rhétorique, pour mériter à la fois tant de griefs opposés ?” mais : “Que peut être le terroriste pour que ces griefs opposés lui semblent ne faire qu'un ? Pour qu'il les emploie indistinctement...”
J'ai dit que la Terreur était banale. Ce n'est pas dire simple, il s'en faut. Mais à qui recherche moins ce qu'elle vaut que ce qu'elle est, deux traits distincts sont aussitôt évidents.
*
L'un serait que le terroriste oscille entre deux phrases de nature différente — prêt à tout instant, sur la moindre indication qu'il reçoit, à passer de l'une à l'autre : la première, faite de pièces et de morceaux, qui viennent à l'instant d'être réunis, assemblage savant, comble de la ruse et de la technique. Et la seconde naïve et nue, toute faite, spontanée, sans qu'il y ait entre ses éléments la moindre jonction artificielle, la plus légère intention. C'est tout l'écart de l'émeraude au ciment armé, de la houille à la brique. Et certes la phrase apparente n'a pas varié. C'est toujours le “je ne farde guère”, le battoir vertueux, l'éperon pur. Mais la Terreur précisément n'avait ici d'autre soin que de dépasser l'apparence. Le mot français louer est aussi l'aspect commun de deux mots locare et laudare (comme dé de datum et digitale). Il est à proprement parler deux mots ; il a deux natures ; mais la conscience courante ne s'y trompe pas plus que le savant. Et simplement le terroriste doit-il plus soigneusement rechercher si le battoir vertueux est phrase construite ou spontanée, artifice ou nature. Il se sert ici, on l'a vu, du moindre indice. Il part sur la moindre piste. Or cette recherche ou ce doute, que trahit son objection, offre un second trait.
C'est qu'il se voit rejeté lui-même, à partir du doute et de l'oscillation, vers la pensée la plus pure de mots. Une pensée avant le langage, s'il en est : puisque le langage ne lui est pas encore assuré. Puisque c'est sur ce langage que l'on hésite.
Qui balance entre une robe de soie et une robe de laine, un chapeau de feutre ou de cuir, ce n'est pas sans être conduit à s'interroger sur l'usage et la raison du chapeau ou de la robe. Remontant ainsi jusqu'à l'intention. Ainsi, qui hésite entre deux mots, jusqu'à la pensée. Il nous semble à l'ordinaire que ce sont nos doigts qui touchent une table, une rampe, une main. Pourtant, celui que le tact étonne ou déroute (comme il arrive quand une boulette de pain paraît double à nos doigts crispés) voit aussitôt ce tact échapper à la main : c'est son esprit seul, pense-t-il, qui s'est trompé. Et le poète ni le critique ne s'interrogent non plus sur le “battoir vertueux”, s'il est concerté ou donné par les dieux, que suivant la première révélation, le choc de pensée profond qu'ils en reçoivent.
Voilà notre terroriste au complet : il est celui que le lieu commun, la figure ou le trope, dans le même temps qu'ils lui donnent à hésiter sur la phrase, renvoient à la pensée — et tel enfin que la Rhétorique nous peignait son écrivain. C'est une découverte bizarre, non pas inexplicable. Car il ne peut plus nous suffire de rappeler que la rhétorique peignait un tel écrivain. Que si la Terreur est à la fois l'état où nous jette la Rhétorique, mais l'état aussi que la Rhétorique par avance nous annonçait, sans doute est-elle, plus que sa suite ou son effet, son intention.
*
On a dit que la Rhétorique, elle aussi, comprenait vraisemblablement la Terreur. Mais il semble qu'elle la comprenne en un sens plus particulier. Quand un chasseur rentre trempé et glacé, il va d'abord, s'il est sage, changer d'habits. Puis il allume son gaz pour faire cuire ses cailles (car il a faim). Après quoi il tourne le bouton de sa T.S.F. pour se réjouir un peu le cœur. C'est là ce que fait le chasseur, s'il est simplement sage. Mais s'il a du génie, il allume un grand feu qui tout à la fois le sèche, rôtit les cailles et lui enchante les yeux.
Et peut-être faudrait-il aussi distinguer entre une littérature de grand feu et une littérature de gaz et d'habits secs. Car la Terreur est sage, qui prévoit l'objection immédiate à quoi se heurte en nous toute règle ou tout cliché. Elle court au plus pressé. Elle nous évite une déception, qu'elle accepte par avance. Mais la Rhétorique prévoit la déception, et prévoit aussi la Terreur. La Terreur sait que l'homme a besoin de se sécher ; mais la Rhétorique sait qu'il a aussi besoin de manger et de se réjouir. Le terroriste connaît la littérature ; mais le rhétoriqueur connaît la littérature, et connaît aussi l'homme qui fait la littérature. Il prévoit (comme il arrive au jeu de dames) un coup plus avant que le terroriste. En bref, le mérite de la Rhétorique pourrait bien être celui-ci : c'est qu'elle se permet la Terreur.
Ainsi verrait-on maintenant entre les deux descriptions, dont l'écart fait le paradoxe littéraire, moins une opposition de sens qu'une différence de portée. Simplement l'une — la terroriste — se rapporte-t-elle à un esprit à deux dimensions qui porte l'objection et s'en tient là : un esprit tout distinct de ses œuvres, et dont il est possible de faire abstraction. Mais la Rhétorique à l'inverse retient l'objection, et retient aussi l'esprit qui l'a faite — jouant ainsi dans une autre dimension, où les rapports de la pensée et des mots se voient renouvelés ; car faire l'objection conduit simplement à rejeter les lieux et les règles, mais être l'objection conduit, par un peu plus de science, à les retrouver et les réinventer — avec une force d'autant plus grande que l'on a manqué les perdre à jamais. On suppose parfois que la Rhétorique s'adressait à des esprits simples. Mais sans doute est-ce nous qui sommes devenus un peu trop simples pour comprendre la Rhétorique. Il nous arrive de dire que la poésie est chose bien plus tragique et profonde que ne l'imaginent ceux qui la veulent réduire au mètre, à la césure, à la rime. Mais peut-être ce qui permettait de la réduire au mètre et à la rime était-il que l'on en formait déjà une conscience plus profonde et plus tragique.
*
* *
L'on sait, depuis Socrate, que la philosophie a bien des mérites, mais un défaut singulier : c'est qu'elle n'est pas philosophique. Pas plus que l'esthétique n'est elle-même esthétique ; ni la morale, morale. Mais chacune de ces doctrines s'achève ailleurs, dans la matière étrangère et résistante qu'elle exerce : faite de folie et de sagesse, de beauté et d'horreur, de bien et de mal. (Ainsi l'entendent les philosophes, qui ne s'appellent pas sages, mais amants de la sagesse).
Que l'on imagine là-dessus de quel prix serait au contraire une morale qui suffit à rendre le lecteur moral, une esthétique qui le fît beau ; une philosophie, sage. Il ne s'agit pas d'une simple chimère.
Car la Rhétorique (si du moins notre analyse est juste) est précisément cette science qui ne peut s'entendre qu'au prix d'un événement rhétorique. Et parfaitement obscure, à son défaut. D'où viendraient, sans doute, le dégoût, l'hésitation, la faiblesse que nous marquions d'abord : c'est qu'il y faut s'engager, et courir le risque.
J'ai dit la faiblesse. Et les diverses passions qui l'accompagnent et la masquent. On s'étonne parfois que les Lettres cherchent moins, de nos jours, la cohérence et la rigueur que l'émotion, la violence, le tremblement, l'à corps perdu. Mais sans doute y a-t-il eu un temps, qu'il dépend de nous de rappeler, où elles étaient assez sûres de transformer pour ne point tant s'efforcer d'émouvoir ; trop efficaces pour avoir besoin d'effet. D'où l'on ne verrait plus guère, en tant de sursauts et d'agitation, que le remords d'une efficacité perdue.
1 - Victor Hugo ↩
2 - Massillon ↩
Texte paru dans la revue Mesures, 15 janvier 1938 - N°1.