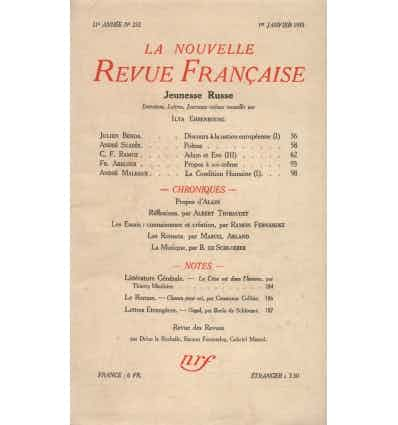
Retour sur Dix-neuf cent quatorze
Jean PaulhanJe me revois, le trois août quatorze, boulevard Sébastopol, devant le magasin allemand de la Salamandre, que l'on commençait à piller. Par terre, il y avait déjà quelques belles paires de souliers, dont une me faisait envie. De jeunes civils agitaient un drapeau en chantant. Moi, j'étais zouave, orné d'une jupe-culotte qui m'eût permis à la rigueur de sauter par-dessus un tabouret, pas plus haut. Des garçons criaient (on l'a souvent dit) : “A Berlin !” Mais la veille, au débouché des faubourgs, j'avais entendu : “Vive l'Allemagne !” Quelle confusion ! On entrait dans une sorte de mythe, et nous étions tous curieux. Un peu fiers aussi : il est trop naturel de trouver ses maîtres ennuyeux, ou sots. Enfin, nous allions les dépasser. Nous allions voir ce qu'ils n'avaient pas prévu. Tout était assez bien fait pour bouleverser le monde. Je n'ai pas emporté de souliers, malgré l'envie. Trois mois plus tard, dans les tranchées, je portais encore la jupe rouge.
Ceux qui partent aujourd'hui, comme ils sont plus sages — et, je pense, plus sagement dirigés. Plus fins, plus justes sans doute. Silencieux : sans cris ni curiosité. Sans pillages. Sans trop de surprise. “Cela seul est clair, dit l'un : la tristesse de ceux que l'on quitte.” Et l'autre : “Il me semble attendre des sentiments, qui me viendront plus tard.” Un troisième : “J'ai fait jusqu'ici ce que je peux. Je vais tâcher de faire, dès demain, ce que je dois.”
Où sont-ils, nous ne le savons déjà plus. Qu'ils vivent tous. Que vive notre pays.
Plus sages, soit. Mais d'une étrange sagesse, faite de vide et d'oubli. D'ignorance, de recommencement. Car les maîtres, après la guerre, se sont rattrapés. Jamais combattants n'ont été moins renseignés, moins enseignés. On a dit “guerre introuvable” de cette guerre-ci qui cherche encore ses champs de bataille et paraît tâtonner. Mais les pensées, plus introuvables encore que les champs.
Jamais les Partis — ces Partis qu'une démocratie prévoyante place comme intermédiaires entre la vérité et nous —, jamais les Partis n'ont été mieux déroutés, ou plus faux. L'un s'avoue stupéfait, comme d'un tremblement de terre. Le second recherche gravement si la guerre ne serait pas, malgré l'apparence, une forme de la paix. Si le dernier semble le moins étonné, c'est qu'il n'a jamais eu d'idées et prend les choses comme elles viennent.
La langue même leur fait défaut, et toute science. Qui oserait tenir encore que Hitler est une invention de la finance internationale ? Que Chamberlain n'est qu'un agent de la Cité ? Il semblait par-dessus tout que l'Europe entière et le monde fussent partagés en deux blocs hostiles : mais voici que le grand chef du fascisme et le maître de l'antifascisme se tiennent embrassés.
A peine voudrait-on penser encore que toute démocratie est pacifique. — Mais Hitler est le président élu d'une démocratie. Qu'il y a Hitler d'un côté, et les Allemands de l'autre. — Mais aux Allemands du moins Hitler n'a jamais menti. Il a été élu sur le programme qu'il applique. Ne me parlez plus change ou capitaux, économie, lutte de classes, comme un traité politique. Il s'agit d'avidité, de fureur, de mensonge, comme dans un roman. D'angoisse, d'alliés, de patrie, comme dans une chanson.
Peut-être nous faudra-t-il du temps pour réapprendre la France. Je prie seulement que l'on nous donne ce temps, que l'on ne nous prive d'aucune raison (fût-elle évidente ou grossière). Que l'on ne nous cache, comme en 1914, ni les noms des héros ni le détail des victoires. Que l'on ne nous empêche pas de penser la guerre, si l'on nous a mal appris à la prévoir. Que l'on ne tienne rien pour sacré — fût-ce une loi, une institution — qui ne puisse être à partir d'elle reconsidéré. Que l'on voie enfin dans les guerriers des hommes réels, non des mythes.
Je ne sais quelle arsouille de Lettres écrivait, en 1922, qu'on “en avait plein le dos, des anciens combattants”. Bien sûr. Mais il faut dire toute la vérité. Si les anciens combattants ont fait suer le joli monde d'après-guerre, c'est qu'ils n'avaient rien reçu ; c'est qu'ils étaient pauvres, avec leurs exigences incertaines de mendiants, dans un monde enrichi. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes en démocratie capitaliste. Certes, depuis que la Révolution a inventé la levée en masse et le service obligatoire, les compliments n'ont pas manqué aux soldats. Ils ont du génie, c'est entendu. Et de la patience, et de la grandeur. Et même on voudrait bien être à leur place. Et tout particulièrement à la place des morts. Hugo le leur a dit, et Claudel. En passant par Béranger, et par le pauvre Péguy. Jamais le guerrier ne s'est vu à tel point révéré, flatté, adoré.
Jamais il n'a été si mal récompensé. Les revues qui payent les romans, non les poèmes, expliquent en général aux poètes que “c'est trop beau pour être évalué en argent”, que ce serait les diminuer, ainsi de suite. Je suppose que les poètes protestent (silencieusement). Je suppose que les combattants vont protester (ou nous du moins à leur place). A la question : “Pourquoi te bats-tu ?” faites que chacun d'eux puisse répondre : “C'est pour être un jour heureux et honoré.” Ou craignez que ne retombent sur vous votre suffisance, vos erreurs et les nôtres. Prenez garde que cette sagesse, dont vous les louez, les fait plus lucides, et plus inflexibles. Je regrette, tout compte fait, de n'avoir pas emporté les souliers de la Salamandre.
Octobre 1939.
(Jean Paulhan, O.C., Tchou)