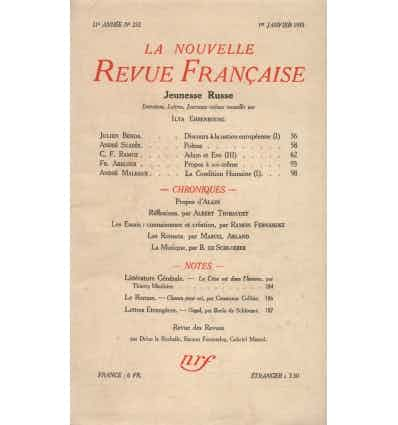
Lettre à un jeune partisan
Jean PaulhanJe vois trop,
mon cher ami,
qu'il y a du vrai dans vos reproches.
“Quelle est votre doctrine ?” demandez-vous. Et je serais embarrassé de vous répondre.
On nous a parfois accusés d'être trop avancés, et parfois d'être retardataires. Parfois incroyants et parfois cléricaux. Parfois trop scientifiques et d'autres fois pas assez. Nous sommes dans l'étrange situation d'un homme à qui les uns reprocheraient d'être trop gros, les autres trop maigre.
Pour tout arranger, il nous est arrivé de répondre que nous défendions la meilleure littérature, et réactionnaire ou avancée, grasse ou maigre, peu importe — mais voilà qui était bien prétentieux. Que nous maintenions, hors des écoles, certaine franchise de l'expression, certaine autonomie littéraire — mais voilà qui reste un peu vague. Puis, il est évident que nous nous attachons à mille autres choses qu'aux Lettres. Ce serait peu : et qu'aux Lettres mêmes nous nous intéressons de biais, plutôt que de droit fil. Jamais il n'a été question, dans ces pages, de la moindre vérité littéraire, jamais nous n'avons tenté de faire école. Jamais nous n'avons pris parti. N'étant ni surréalistes, ni néo-classiques, ni fantaisistes, ni réalistes, il peut sembler à la fin que nous ne sommes rien du tout. Puis, quel bienfait attendre, en ces matières, d'une orthodoxie, si proche de l'indifférence ou du vide — quelle révélation, quel salut ?...
Ici, vous ajoutez quelques mots, que je lis mal. Avez-vous bien voulu dire que la revue risquait d'être trop adroite ? C'est que vous songez peut-être à cette sorte de concours, où nous invitait naguère François Mauriac. Rassurez-vous en ce cas. Nous avons toujours été maladroits : il n'a pas fallu moins de vingt à quarante années et de quelques guerres, pour que Gide ou Saint-John Perse (entre autres) fussent, je ne dis pas reconnus, aperçus des Académies et des grands critiques, et l'orthodoxie dont je vous parlais a ce trait du moins : c'est qu'elle n'est pas évidente. Nous avons eu la patience qu'il fallait, nous l'aurons encore. S'il faut prendre part au concours Mauriac, nous jouons volontiers perdants.
“D'ailleurs, dites-vous encore, mon Parti n'admettait pas...” Voilà qui est plus clair. A ce propos...
1 - Le mariage, l'incendie et autres incidents
J'imagine que vous vous êtes marié ce matin. Ce n'est pas un mariage de convenance. Vous épousez justement la femme que vous désiriez épouser. Elle vous paraît charmante : aussi charmante qu'on peut l'être. Bien. Dans l'après-midi vous l'emmenez au théâtre. Vous n'avez pas mal choisi la pièce ; c'est du Shakespeare (pour ne vexer personne). Il n'y a qu'un malheur : c'est qu'au second acte le théâtre prend feu. La préfecture de Police a oublié de vérifier si les bois étaient ignifugés. Ils ne le sont pas : ils flambent comme de petites allumettes, ils sèment la déroute dans les spectateurs, qui s'enfuient en pagaille et commencent à s'aplatir les uns les autres. Heureusement, il se trouve un monsieur — qui n'a pas l'air particulièrement génial ni malin (ni même, entre nous, très bien habillé), vraiment le premier venu. Eh bien, il se trouve que ce premier venu a de la décision. Il commence par assommer le méchant spectateur qui piétinait déjà sa voisine pour s'en aller plus vite. Il met les autres en rang, on se croirait à l'exercice. Enfin il organise, comme on dit, l'évacuation. Il n'y aura que deux ou trois dames carbonisées, nous nous en tirons à bon compte. En tout cas, la vôtre (de dame) n'en est pas.
Il me semble me rappeler, mon cher ami, que vous m'avez traité l'autre jour de vieux libéral. Et que diable voulez-vous que je sois ? Voilà qu'en cinq heures — si je me mets à la place du jeune marié — il m'a fallu successivement être démocrate, partisan de l'aristocratie et royaliste (ou fasciste, si vous aimez mieux — c'est ici tout un). Royaliste, s'il est des dangers où la seule ressource est d'obéir aveuglément à qui n'est pas le plus éloquent, ni le mieux habillé, ni sans doute le plus intelligent. Aristocrate, car enfin vous avez choisi, pour aller voir sa pièce, le meilleur (à votre sens) des auteurs dramatiques. Démocrate, puisque vous désirez, et même exigez au besoin, que votre femme ne soit pas choisie par vos vieux parents — même si vous avez pour eux l'affection qu'ils méritent — ni par votre médecin, fût-il le meilleur du quartier. Non, vous voulez la choisir vous-même. Vous ne lui demandez pas d'avoir reçu un prix de beauté ni d'être capable d'écrire un recueil de poèmes. Non, vous la prenez pour une foule de raisons subtiles et personnelles, que vous seriez bien en peine de justifier, ou seulement d'expliquer. Et même que vous tenez à ne pas expliquer.
Qu'y faire ? Ainsi va la vie. Ainsi sommes-nous contents qu'elle aille. Le jour où l'évacuation du théâtre sera organisée par votes et par discussions, suivant les sages principes de la démocratie, il n'y aura pas quatre dames carbonisées, mais quatre cents. Le jour où votre femme vous sera imposée par le médecin de la famille, et où les seuls auteurs bien vus du gouvernement verront leurs pièces jouées, vous découvrirez à votre surprise l'agrément qu'il peut y avoir à vivre sans théâtre, et sans épouse.
Non, la vie n'est pas simplement — comme le voudraient les Politiques — un mariage. Ni un spectacle. Ni un incendie. Elle est tout cela, tour à tour. Et je ne suis pas fâché qu'il me faille être démocrate le matin, l'après-midi aristocrate et le soir royaliste. Ce qui peut, bien sûr, dans l'ensemble, s'appeler libéral. Mais mon libéralisme n'est pas fait de tiédeur, ni d'indifférence. Il est la simple liberté que je prends d'être, suivant le cas, violemment royaliste, vivement aristocrate, démocrate avec ardeur.
J'ai peur d'avoir choisi des exemples un peu voyants. Oublions-les. Donc, vous vous habillez pour allez déjeuner chez un ami. Vous mettez votre cravate bleue, qui vous plaît décidément mieux que la verte. Votre bouton de col s'échappe, et vous vous précipitez à sa suite, pour l'attraper avant qu'il ait roulé sous l'armoire. Entre-temps, vous vous êtes mouché. Vous voilà passé en trois minutes par l'état aristocratique (la meilleure cravate), royaliste (énergique décision de jeter par terre tous vos bras et vos jambes à la poursuite du bouton), démocratique (vous ne faites pas du tout appel pour vous moucher à quelque spécialiste du mouchage, infirmière, assistante sociale ou autre). Les vieux philosophes disaient que l'homme est fait d'une tête, d'un cœur et d'un ventre. Ils ajoutaient, je crois — en tout cas ils auraient pu ajouter —, que la tête est royaliste, le cœur communiste et le ventre plutôt fasciste et totalitaire, avec ce qui s'ensuit.
Tout homme est un homme universel. Qui sait juger, mais qui est tout à fait capable de réfléchir. Qui sait inventer, et qui sait aussi se plier aux inventions d'autrui. Capable de tendresse ou de violence ; d'équité comme d'injustice ; d'intérêt, mais de détachement. Ce serait peu : doué, par-dessus le marché, d'on ne sait quel esprit rétif, difficile, insaisissable. Ainsi tour à tour lion, tortue, hydre ou licorne. Universel à donner le vertige. Mais notre affaire à nous qui nous mêlons de politique (comme les lois nous en font le devoir), c'est tout de même d'accorder cette hydre et cette tortue, ce révolutionnaire et ce fasciste. Voilà qui n'est pas si aisé. Alors, bien entendu, les partis politiques me paraissent plutôt de l'ordre de la plaisanterie.
C'est une plaisanterie qui a son charme (comme la plupart des plaisanteries), mais qui devient tout de même excessive quand on exige de vous que vous fassiez choix d'un parti. Excessive et même tragique quand on vous punit pour avoir pris le parti qui n'était pas le bon, je veux dire celui qui n'a pas réussi. Alors que la sagesse consisterait sans doute, pour le citoyen soucieux de la bonne marche de la société, à prendre obstinément, afin de rétablir un équilibre à tout moment compromis, le parti qui n'est pas “le bon” : démocrate dans le triomphe des dictatures, mais royaliste dans le triomphe des démocraties. (On sait de reste que le bon citoyen passe en prison le plus clair de sa vie.)
Remarquez que je ne me prononce pas sur les partis. Il se peut qu'ils soient efficaces, il se peut qu'ils soient nécessaires. Et il suffit en tout cas qu'il y en ait un seul pour que les autres deviennent souhaitables. Une nation que nous connaissons bien se partageait, tout récemment encore, entre le parti des sortants et le parti des rentrants qui occupaient le pouvoir tour à tour : les uns tenaient que la grande affaire pour l'homme était de savoir sortir de sa maison, les autres de savoir y rentrer. (Et je n'ai pas besoin d'ajouter que les sortants étaient plutôt progressistes, mais les rentrants plutôt réactionnaires.)
Il se trouva quelque jour un petit garçon pour observer que l'on ne pouvait sortir qu'à la condition d'être d'abord rentré, ni rentrer qu'à la condition d'avoir commencé par sortir. Mais on ne prêta guère attention à une remarque stupide à force d'évidence.
2 - Les partis contre le premier venu
Me direz-vous qu'il n'est pas tout à fait exact, qu'il est imprudent en tout cas de parler d'une société — d'un pays, d'une nation — comme si c'était une personne : n'importe quelle personne, vous, moi, le premier venu. Que les États-Unis ne sont pas un oncle, ni l'Angleterre un lion ou la France une Marianne. Soit. Observez du moins qu'il leur faut bien se conduire comme s'ils étaient une personne, et même (le plus souvent) une personne exceptionnelle, une personne indépendante, réfléchie et pourtant décidée.
Entre les régimes divers — il n'y en a pas eu moins de seize ! — que nous avons connus depuis la Révolution, on distingue aisément ceux qui relèvent plutôt du mariage, ceux de la pièce de théâtre, ceux de l'incendie. Il est même arrivé que la France ait été tout cela d'un coup. C'est entre 44 et 45 qu'elle disposait en même temps d'un roi (ou, si vous préférez, d'un dictateur), Charles de Gaulle ; d'un Parlement élu, la première Constituante ; d'un Conseil des Meilleurs, le Comité national de la Résistance (qui préparait les décrets et veillait à leur application). Donc à la fois aristocrate, démocrate, royaliste, unissant en un seul bloc, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous les partis.
L'expérience, dites-vous, n'a guère duré. Soit. Mais elle peut recommencer demain. Mais elle a formé de la France, durant quelques mois, une seule personne. Puis c'est d'hommes que les sociétés sont faites, c'est par les hommes que nous les tenons, c'est aux hommes que tout revient à la fin. Qu'est-ce que la République de Platon ? C'est un traité de gouvernement — oui bien, du gouvernement de l'homme par lui-même. Le Contrat social de Jean-Jacques ? Un traité de l'obéissance — oui, du citoyen aux autres citoyens ses égaux. Le Capital de Karl Marx ? Un traité de la libération — oui, de l'homme asservi par l'homme. Nous ne sortons pas de lui, personne n'en est jamais sorti. Il est assez vaste pour contenir le monde entier s'il n'est, en ces matières, pas un mot qui ne se rapporte à lui, ni une pensée qui ne le concerne. Quant aux partis...
Pensez-vous donc que je ne voie pas leurs mérites ? D'abord, ils nous intéressent aux hommes. Ils nous donnent sur eux une ouverture, une prise de vue. Partiale certes, et partielle. Mais à voir ces hommes à la fois tout entiers, qui ne perdrait la tête ? et c'est au vertige qu'il nous faut d'abord échapper. Il est des sujets si graves et complexes — des sujets à n'en pas finir — que le plus sage est sans doute de les aborder par fragments. Encore est-ce à la condition de tenir le fragment pour ce qu'il est : un morceau de la vérité, non la vérité tout entière. Voici le danger.
C'est qu'une illusion régulière nous montre comme un tout le petit fragment que nous connaissons, si mince soit-il, d'autant plus qu'il est plus mince. Nous jugeons naturellement du corps médical tout entier sur les deux ou trois médecins qu'il nous est donné de connaître, et de l'immense Chine au complet sur le seul Chinois que nous ayons pour ami — du corps social tout entier sur un mariage (ou bien un spectacle, ou encore un incendie) et les renseignements que nous possédons sur un sujet donné se comportent dans le ballon de notre esprit, non pas comme un liquide dont le volume constant montre la place libre qu'il reste à remplir, mais comme un gaz qui du premier coup occupe tout l'espace.
Qui donc a dit : “Notre parti au pouvoir, les autres partis en prison” ? Mais bien sûr tous les partisans. Et le moins qu'il faille dire des partis, c'est qu'ils ne sont pas longs à prendre eux-mêmes un parti. Or c'est toujours le même qu'ils prennent : totalitaires, dévorants. Et par là bien plus proches les uns des autres qu'il ne semble. On s'étend volontiers sur l'opposition des partis, sur les abîmes qui les séparent, sur l'impossibilité où est un homme de droite de comprendre un homme de gauche. On remarque moins à quel point ils se ressemblent, s'accordent : et, si je peux dire, n'en font qu'un. C'est toutes les fois qu'il s'agit de vexer l'homme de la rue, le premier venu, cet homme surprenant qui a réponse à l'incendie comme au théâtre, au théâtre comme au mariage : cet homme qui a réponse (et question) à n'importe quoi — nous tous.
Il n'est pas un homme normal qui ne souhaite avoir sa maison à soi, de préférence différente des maisons voisines, avec des malles poilues dans un grenier et des chaises un peu cassées. Avec un toit, sur lequel il puisse monter. Avec un petit jardin qu'il orne à sa façon de trottoirs de coquilles et d'escargots de faïence. Or c'est ce qu'il n'a pas. C'est, de toute évidence, ce qu'il n'est pas près d'avoir. Qui s'y oppose ? D'un côté, le parti des Conservateurs, les grands propriétaires terriens qui préfèrent garder leurs terres — fût-ce en friche — que les donner. De l'autre, le parti communiste qui ne veut pas laisser un seul de ses membres échapper à sa classe de prolétaire, et par là à son parti.
Il n'est pas un homme normal qui ne trouve qu'il travaille trop et qu'il aurait besoin d'un peu plus de loisirs — ne fût-ce que pour bêcher le jardin ou s'asseoir par terre et faire la dînette avec sa femme et ses enfants. Or ce sont ces loisirs que lui refusent violemment les gens de droite comme les gens de gauche. Ceux-là, c'est parce qu'ils exigent du rendement et craignent, il se peut, les réflexions que l'on se fait aux moments de loisir. Bref, des ouvriers un peu abrutis les arrangent très bien. Mais ceux-ci, dès la révolution faite, n'ont rien de plus pressé que d'abolir les jours fériés, proclament le Droit au travail. Les révoltés de 1848 n'exigent (à coups de fusil) que le droit de passer à l'usine douze heures par jour. Les Fédérés de 1871 s'appellent eux-mêmes la Révolution du travail. Nous avons tous entendu parler de Stakhanov. Bref, des ouvriers légèrement abrutis leur conviennent très bien.
Il n'est pas un homme normal qui ne trouve que les riches tiennent dans ce monde-ci trop de place et usurpent trop d'autorité. Mais qui saurait leur faire pièce ? Les partis dépensent gros. Ils ont leurs frais de publicité, leur propagande, leurs affiches et leurs banquets. Bref, cent mille dépenses, et pas de recettes. Il en coûte cher pour faire élire un député, plus cher pour un ministre. Qui donnera l'argent, sinon les Riches ? Or ils exigeront d'être payés, sinon en monnaie, en honneurs, en monopoles, en influence. Et jusqu'à L'Humanité, on le sait, a été fondée par douze grands capitalistes.
Faut-il s'étonner encore que le peuple, depuis cent soixante ans, n'ait jamais eu la parole ? Il suffit bien d'écouter les Partis. Il n'en est pas un, soit réactionnaire ou révolutionnaire, qui ne déclare, à ses moments de franchise, qu'il faudrait profondément changer — les institutions, passe encore, mais les hommes ! pour obtenir un état politique passable. Or ce que sait le premier venu de science sûre, c'est qu'il faut au contraire faire de bonne politique avec l'homme de la rue tel qu'il est, buté, un peu flemmard, passionné, pas du tout sot, ami de l'égalité et plutôt anarchiste, avec sa tête à lui et son cœur et son ventre — tel qu'il a toujours été, tel qu'il sait très bien s'accommoder d'être.
Or c'est cet homme-là que les partis commencent par supprimer. Lui, en vient à douter de son existence. Staline, d'accord avec le Comité des Forges, lui dit qu'il faut travailler aussi bien qu'une machine. Il le croit. Il imitera la machine. Il a oublié ce qu'il est. Il a oublié qu'il a réponse à tout. Il a oublié qu'il a question à tout. Quand les Grecs inventèrent le moulin à eau, le poète Antipatros écrivit : “Dormez vos matinées en paix, jeunes meunières, les nymphes des eaux travaillent pour vous.” Mais les jeunes meunières de nos jours se lèvent à trois heures du matin, pour faire mieux que des nymphes.
3 - Petit projet d'architecture
Certain jeune homme, que j'ai connu, avait un jour décidé de vivre dans un monde vert : c'est qu'il avait appris, au Centre d'Information de la Couleur, que la couleur verte donne la paix et l'espoir. (Comme on en a vu mille exemples sur les poules américaines et les membres des Conseils d'administration.) Or il était, par nature, d'humeur difficile. Le voilà donc qui passe au ripolin son stylo, sa machine à écrire et son sous-main. (Secrétaire, de son métier.) Puis les couvertures de ses livres, la tapisserie de sa chambre, les murs de sa petite maison. Il se trouvait par chance, héritier, et petit propriétaire.
Ensuite vinrent les envois à l'étranger, les essais de colonisation : le chat de la voisine, que l'on trempe dans un pot de peinture, les cartables (verts) qu'on offre aux petites filles de l'école ; les manteaux, aux dames de la rue. Il lui arriva de se faire dire des gros mots, il lui arriva de se faire dire des mots trop tendres. On l'emmena plus d'une fois au poste, un poste de couleur grise, et même grisâtre : décourageant. Il tenait bon. Il avait pris le parti du vert, et somme toute il en était récompensé, puisqu'il voyait chaque jour ce vert s'étendre un peu plus loin, gagner un pavé de plus, un nouvel arbre, une grille d'arbre. Bref, il était totalitaire, comme tous les partisans. Totalitaire, et satisfait de l'être. C'est alors qu'arriva l'accident.
Ce fut un accident horrible, et (à son sens) invraisemblable. Certes, il avait déjà soupçonné, sur ses murs, plus d'un reflet suspect. L'excellent manteau, dont il venait de faire cadeau à une vieille dame, s'était légèrement métamorphosé sous ses yeux : il les avait vite fermés.
Il lui était arrivé de voler en rêve au-dessus d'un gazon suspect : pas vert du tout, au contraire. Il avait vite ouvert les yeux. Au réveil, il lui arriva de se mettre en fureur, d'une manière inexplicable. Plus de doute à la fin : il y voyait rouge, avec tout ce qui s'ensuit. Il avait beau désormais fermer les yeux ou les écarquiller : toujours poursuivi par quelque traînée de pourpre ou de rose. C'est dans la colère qu'il peignit son dernier pavé, et dans le désespoir son dernier tronc d'arbre. Car il s'arrêta bientôt. Le vert était toujours là, c'est la raison du vert qu'il avait perdue.
Ne me dites pas, mon cher ami, qu'il jouait ici la plus simple des lois physiologiques (l'induction, sauf erreur) et que le jaune n'appelle pas moins régulièrement dans notre œil le bleu (ou le vert, le rouge) que la timidité dans notre esprit l'extrême orgueil ; ou la démocratie, le fascisme. Nous savons tout cela, et ce n'est pas le trait d'un parti le moins frappant qu'il soit prêt à tout instant à devenir le parti opposé. Ce sont les farouches révolutionnaires qui font les grands conservateurs, et les fascistes qui font les meilleurs communistes. (Et le mot de dialectique, à bien le prendre, ne veut pas dire autre chose.)
Je ne songe pas à ces opinions, auxquelles il arrive qu'on se rallie sans les adopter, par opportunisme. (Ainsi Sartre se range-t-il au côté des communistes, encore qu'il voie dans le matérialisme dialectique un attrape-nigaud ; et Maurras l'incroyant soutient le parti catholique ; ou Benda le panthéiste, adversaire de Marx, le marxisme.) Non, ces opinions-là ne changent guère. C'est qu'elles sont de surface, et, n'y croyant pas, comment cesserait-on d'y croire ? Mais les autres !
Alain se proposait, vers 1920, de regrouper les combistes. Or il n'y en avait plus un seul : certains d'entre eux étaient devenus communistes, les autres nationalistes. Le père Combes lui-même, longtemps avant sa mort, avait changé de parti.
On citait, dès 1914, en tête des objecteurs de conscience et des pacifistes irréductibles, Remy de Gourmont, révoqué naguère pour antipatriotisme, mais qui devait écrire durant la guerre les pires fadaises ; Anatole France, mais qui demanda à s'engager ; Romain Rolland, mais qui devait se prononcer en 1938 pour une guerre impitoyable. Plus tard vinrent Jean Prévost, mais qui mourut en héros dans les combats du Vercors ; André Chamson, mais qui devint, colonel et Résistant ; André Malraux, mais qui a violemment pris part de 1935 à 1944, de la Chine à l'Espagne, à toutes les guerres qui se sont offertes. Quand les Allemands en 1940 occupèrent Paris, ils furent surpris de n'y trouver qu'un journal et qui s'appelait La Victoire. C'était le journal de Gustave Hervé, bien connu pour avoir vomi la guerre et l'armée, et planté le drapeau français dans le fumier.
L'Allemagne, qui était tout entière socialiste en 1920, se retrouvait fasciste tout entière (ou peu s'en faut) en 1938. Qu'est-elle aujourd'hui ? Démocrate et chrétienne, semble-t-il. Quant à la France, on sait de reste qu'elle est gouvernée, depuis cinquante ans, par des marxistes. C'est ce que personne ne devinerait sur l'effet. Pourtant Viviani était marxiste, et Briand. Jules Guesde était marxiste : il était même marxiste de pure observance. Millerand était marxiste et Augagneur, et Pierre Laval (qui répliquait à la Chambre à quelque adversaire : “Vous feriez mieux d'aller lire Marx”). Léon Blum l'était aussi (avec quelques réserves) et Félix Gouin et Vincent Auriol. Comme on voit, les marxistes français sont très régulièrement devenus ministres d'État, présidents du Conseil, présidents de la République.
Il est étrange de penser qu'il n'a fallu rien de moins que les analyses méthodiques et les dénombrements, les anticipations, les éclairs de génie et les confusions naïves, la méthodique accommodation du monisme hégélien à l'ontologie matérialiste et la foi dans un âge d'or, la réflexion rigoureuse du pauvre Marx (et les grands besoins de son cœur) pour étayer tant de gouvernements honnêtes et timorés — mais pour permettre aussi la dictature la plus impitoyable qui se soit vue de nos jours, l'homme plus farouche que Gengis khan et plus cruel que Nabuchodonosor, qui tuait ses femmes, torturait ses amis, exterminait par millions les koulaks russes et les résistants polonais, les sociaux-démocrates et les trotzkistes, et créait des camps de mort lente aux dimensions de l'une de ses républiques — d'ailleurs, non sans génie. Quoi, l'on a vu tout près de nous le parti de la justice sombrer, à peine fut-il vainqueur, dans l'injustice, la spoliation, les tortures. De qui tenait-il sa bonne conscience ? D'un Emmanuel Mounier, qui se réjouissait en 1941 de la victoire allemande sur les Russes ; d'un Astier de La Vigerie, en 1935 antisémite et partisan de Doriot, et faut-il citer Paul Eluard, André Marty, Maurice Thorez ? Le conseil de rédaction du meilleur journal communiste, les Lettres françaises, réunissait vers 1945 Claude Morgan, camelot du roi, Claude Roy, naguère encore royaliste, Aragon, venu de l'anarchie. Qui mène aujourd'hui, avec une rigueur inflexible et un étrange déploiement d'efforts, la guerre d'Algérie ? Les mêmes socialistes qui se sont fait élire aux cris de “Halte à la répression algérienne”.
Et moi, dois-je me fier au Mounier de 41 ou à celui de 44 ; à l'Aragon de 30 ou à celui de 32 ; au Guy Mollet de décembre 1955 ou à celui de janvier 1956 ? Étranges vérités, qui sont à la merci de quelques années de guerre, d'une saison, d'un équinoxe.
On me dira qu'ils parlaient tous sans savoir, au petit bonheur. En ce cas n'auraient-ils pas dû se taire ? Non, leur honnêteté saute aux yeux. Je préfère supposer que c'est l'esprit partisan qui leur a joué l'un de ces tours que nous savons.
Car nous les savons, et je m'étonne que cette science ne soit pas encore entrée, comme on dit, dans le domaine des réalités — qu'il n'en ait pas été fait la moindre application pratique. Puis-je en proposer une aux architectes ? Je songe à cette absurde disposition de nos Parlements en hémicycle, d'où proviennent une bonne part de nos idées touchant la politique. Au lieu qu'un cycle complet, un monument parfaitement circulaire, comme sont les Arènes de Nîmes ou la mairie d'Ambert, donnerait à chaque citoyen la meilleure leçon, je ne dis pas de concorde ou de bonté — car il resterait à savoir si concorde et bonté sont choses désirables —, mais en tout cas d'intelligence, et les députés perdraient assez vite l'habitude déplorable qu'ils ont prise de se battre, au début de chaque session, à qui ne sera pas à la droite du président. Mais si ce président, avec ses secrétaires, ses questeurs et son orateur, se trouvait placé au centre des arènes, sur une tour, ou plate-forme tournante (tournant lentement, pour n'étourdir personne), il serait évident à tous les yeux qu'il faut considérer dans le communiste le réactionnaire qu'il sera demain, dans le royaliste le révolutionnaire, et l'homme des excès dans le républicain modéré, toutes choses que nous connaissons certes. Mais il est très différent de connaître (comme vous dites dans votre parti) les données objectives du monde, et d'y être pris — de s'y trouver coincé. A peu près aussi différent que d'étudier la chute des corps, et d'être soi-même le corps qui tombe d'un cinquième étage.
Et que faire en ce cas ? me direz-vous. Oui, c'est toute la question. Au fait, vous ai-je dit ce qui se passa pour notre jeune homme ?
Il se passa qu'il devint peintre. Non pas l'un de ces grands spécialistes, qui occupent les Galeries. Il peignait le dimanche : l'un de ces peintres pour eux-mêmes, qui s'enchantent de leurs tableaux, mais ne cherchent pas trop à enchanter les voisins. Peintre comme chacun de nous est à sa manière écrivain.
Qu'était-il arrivé ? Peut-être avait-il trouvé la clef — je veux dire le point de réflexion, d'où il disposait, et même abusait s'il faut tout dire, à son gré du rouge et du vert, du jaune et du bleu ; si vous aimez mieux (pour revenir à notre sujet), de la démocratie et du fascisme. Peut-être supposait-il simplement qu'à force d'attendre cette réflexion, et de lui faire place libre, il arriverait bien un jour que la réflexion vînt enfin l'occuper.
Les philosophes ont parfois rêvé d'une grammaire des idées qui fixerait d'une pensée à l'autre les mêmes liens qu'établit entre les mots la grammaire tout court. Eh bien ! il me semble qu'une telle grammaire commencerait par faire place, entre les opinions extrêmes, à je ne sais quel vide et quelle absence, quel état d'extrême milieu, bien plus proche d'un secret que d'un aveu, d'une ignorance que d'une doctrine. Et dont il est plus facile de former le pressentiment que l'idée claire : somme toute, non moins mystérieux qu'un homme — et nous devant elle, en effet, tout maladroits.
Laissons cela. Il faut remplir votre stylo, mon cher ami, et mettre de temps en temps des majuscules. A vous relire à la loupe, je crois décidément que vous m'avez écrit, non que la revue risquait d'être trop adroite, mais bien trop à Droite (à Droite, au sens des partis). Mais, là-dessus, je n'arrête pas de vous répondre. Je n'ai pas fini.
Novembre 1956
(Jean Paulhan, O.C., Tchou)