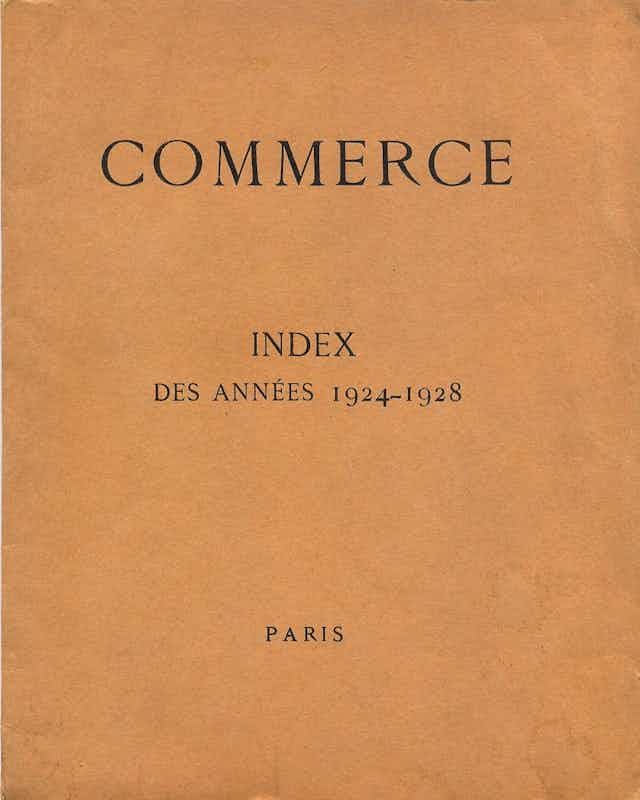
Les Gardiens
Jean PaulhanChère amie,
Voici une histoire que je voulais donner à "Commerce". Mais laissez-moi d'abord la raconter à vous seule.
On peut supposer que c'est une femme qui parle :
Ma mère n'avait jamais été bavarde. Quelques mois avant sa mort, elle cessa tout à fait de causer avec moi. Mais elle se mit à parler à mon père bien plus souvent, et plus fort, qu'elle ne l'avait fait encore.
Et même il leur arrivait d'avoir des discussions vives, que j'entendais à travers les murs. Je m'en étonnais. Je n'en connus le sens qu'un peu plus tard, lorsque ma mère fut morte dans sa soixante-deuxième année : mon père était en train de perdre la raison.
(Je n'aime pas beaucoup qu'il y ait des fous dans les histoires, et vous non plus. C'est surtout parce qu'on nous les présente avec un air de dire : si seulement vous étiez capable de devenir fou... Rassurez-vous, celui-ci, ou ceux-ci — il y en a deux — seront assez ternes, et plutôt décourageants.)
Mon père était un peu plus jeune que ma mère. Il se rattrapa de reste, et vécut encore trois ans, pendant lesquels sa folie ne fit que grandir. Je puis imaginer à présent, d'après les discussions qu'il eut avec moi, celles qu'il soutenait avec ma mère. Je ne cherchais qu'à le convaincre sans lui faire de reproches, et jamais nous n'allions jusqu'à la dispute ; ma mère, qui était accoutumée à traiter avec lui d'égale à égal, bien entendu ne pouvait avoir ma patience.
Et je ne pense même pas qu'elle se soit jamais représenté exactement l'état de son mari. Elle avait un caractère entier : que mon père, par exemple, désirât prendre le thé ou se promener avec moi lui avait toujours paru le signe de tant d'absurdité qu'elle n'en pouvait trouver davantage dans le feu qu'il mettait aux rideaux sans chercher à l'éteindre, ou dans les bougies de toutes couleurs, qu'il amassait dans un coin du placard.
Car tout ce qui avait trait à la lumière et au feu préoccupait dès lors mon père. Il vivait dans la crainte que l'électricité vînt à s'éteindre. L'électricité, et non pas les lampes à pétrole, ni les bougies. J'ai remarqué plus tard que sa folie consistait moins à former des pensées absurdes qu'à se défier au contraire de tout ce qui lui paraissait, dans le monde, étrange ou mal expliqué. Il va de soi que l'électricité est mystérieuse ; il est plus sage de croire aux bougies. Sur cette seule sagesse mon père voulait se guider. Il ne tint plus aucun compte de ce que lui montraient nos lampes électriques. Mais il se heurtait aux chaises et tâtonnait avant de trouver sa fourchette ou sa canne, tant qu'il ne les avait pas vues à la lumière de l'une des bougies qu'il portait dans ses poches et allumait à tout bout de champ, ou bien encore d'un rat de cave, auquel il se fiait d'une façon particulière.
Son orgueil eût bien suffi à retenir ma mère d'admettre que son mari pût devenir fou. Elle avait pourtant, dans la famille, l'exemple déjà de mon frère.
*
* *
(Je n'ai pas songé à vous donner un titre. Ce pourrait être : “le gardien” ou plutôt “la gardienne”. Bien entendu, le personnage le plus intéressant est celui qui fait le récit. Mais vous ne le verrez qu'à la fin.
Je crois que l'histoire peut se passer n'importe où.)
Mon frère Georges habitait avec nous. Je ne pense pas que le traitement du docteur Chardon, qu'il avait suivi deux ans, ait beaucoup amélioré son état. Je ne l'ai jamais vu prêt à devenir intelligent que lorsque Mademoiselle Georgina venait chaque jour lui donner une leçon. Il avait alors douze ans ; non seulement il prenait plaisir à lire, mais il exigeait de lui-même de nouveaux livres, dont il nous donnait le sujet. Pourtant, du jour où mère exigea qu'il lui fît à haute voix la lecture pendant qu'elle brodait,
(Je ne sais si vous vous apercevez que cette mère est une sorte de diable)
sa curiosité diminua. Il réclamait, dans ce temps-là, des livres d'histoire ancienne ; or il devint assez vite incapable de prononcer les noms propres. Toutes les fois qu'il en rencontrait un, il prenait le parti de tendre le livre à ma mère, qui s'arrêtait de broder.
(Pardonnez-moi de vous le dire. Mais il est assez important, pour la suite, de remarquer que si Georges était naturellement un peu arriéré, il a dû aider à sa folie, accepter d'être un peu plus fou, pour qu'on cessât de l'ennuyer.)
Bientôt il lut machinalement entre les noms propres, et de toute évidence, sans rien comprendre à ce dont il était question. Les séances de lecture devinrent pénibles au point que ma mère, malgré son désir d'aider aux progrès de Georges, dut lui demander de cesser. Dans la suite, il montra une grande défiance des livres. S'il lui arrivait d'en ouvrir un, c'était toujours en cachette.
Sa langue était repliée dans sa bouche, ce qui empêchait de toute façon qu'il pût lire à haute voix d'une manière claire ou agréable.
*
* *
(Est-ce que le ton n'est pas un peu enfantin ? Mais justement, il faut peut-être supposer que c'est une petite fille de treize ou quatorze ans qui raconte la chose, avec cette grande raison, que l'on perd à dix-sept. Comme vous voudrez.)
Je n'ai jamais vu Georges très attentif aux gens ; et je doute même s'il faisait une grande différence entre ma mère et moi. Pourtant lorsque nous prîmes dans la maison, pour nous aider, la vieille Marie, Georges montra de la surprise en la voyant balayer la chambre à notre place, ou servir le dîner. Il la suivait des yeux et cherchait parfois à lui toucher les cheveux ou la robe. Mère avait toujours exigé, pour l'intéresser à quelque chose, qu'il prît lui-même son couvert dans le buffet. Mais au moment d'aller le chercher, il se tournait à présent vers Marie, la regardait avec patience et ne se levait enfin que lorsqu'il était sûr qu'elle ne l'avait pas compris.
Mon père dans son nouvel état l'intéressa, autant qu'avait fait Marie.
(Il est vrai que c'est une grande surprise, et même pour tes animaux, de découvrir que les hommes peuvent avoir des domestiques. Orso, qui d'abord se montrait gêné de sa présence et tournait sottement autour d'elle, a pris depuis quelques mois avec notre femme de ménage un ton orgueilleux et des manières de pattes qu'il n'a jamais eues avec nous.)
Georges s'asseyait souvent près de lui et le regardait d'un air attentif et contraint. Il arrivait qu'à table, après avoir pris deux ou trois bouchées, mon père s'endormît brusquement. Georges souriait d'abord, comme s'il avait cru à un jeu. Mais le sommeil durait : il se rapprochait alors de mon père, et si je ne l'en avais empêché, il lui eût touché les yeux ou le front. Les bougies l'amusaient ; il s'employait volontiers à les allumer ou à les éteindre : cela jusqu'au jour où, mon père ayant piqué l'une d'elles dans ma boîte à ouvrage, les étoffes prirent feu ; après les étoffes, les doubles rideaux et jusqu'aux rideaux de mousseline. Georges eut grand-peur, mais il continua, tout en se défiant de lui, à observer mon père du plus près qu'il pouvait.
Il devint dans le même temps paresseux : j'avais toutes les peines du monde à l'éveiller le matin à neuf heures ; encore se rendormait-il souvent. Je supposai que les efforts de pensée qu'il lui fallait faire l'avaient épuisé ; ils n'étaient pas tous inutiles. Il arrivait qu'il nous rendit service.
Ai-je dit que mon père perdait la conscience jusqu'à ne plus me reconnaître. Recevant ses amis, il me présentait à eux comme sa femme. Les amis ne me connaissaient pas toujours, certains d'entre eux pouvaient croire que mon père s'était remarié.
(Par conséquent, c'est une jeune fille qui raconte l'histoire. Il n'y a pas de doute.)
L'on pense bien que je ne pouvais guère m'éloigner de la maison. Un jour pourtant, je dus aller chez le dentiste ; je m'étais cassé la veille une dent. J'avais choisi l'heure de la sieste. Mais voilà mon père qui se réveille plus tôt que d'habitude, et me réclame, et décide d'aller m'attendre à la porte du dentiste. (C'est ainsi qu'il faisait avec ma mère, lorsqu'elle avait des dents à soigner.) Marie tâcha de le retenir, jusqu'au moment où il la traita de saleté et d'assassin. Georges alors lui apporta sa canne et son chapeau, montra beaucoup d'entrain, et le conduisit jusqu'à la vieille porte du jardin, que jamais personne n'avait pu ouvrir. Ils n'y parvinrent pas non plus ce jour-là, et le scandale fut évité, sans compter tous les accidents, qui auraient pu arriver à mon père sur la grand-route.
*
* *
La nuit, il n'est pas un bruit que je sois libre de laisser aller. Une porte qui craque, un coup sur un mur, je me rendormirais si j'étais libre ; non, il me faut tâcher de tout rendre clair. Ce grincement, c'est mon père qui repousse en se levant la chaise sur laquelle il pose ses habits.
Le voici qui sort de la chambre, en chaussettes. Il jette un coup d'œil sur ma porte, ne me voit pas, descend une marche. Là-dessus, sa bougie s'éteint. Je l'entends dans le noir qui descend une seconde marche et s'accroche à la rampe si fort que la rampe craque. Puis il frotte une allumette. Il porte à la main son trousseau de clefs.
La bougie s'éteint encore, sans qu'il ait fait le plus petit mouvement. Il frotte une nouvelle allumette, qui rate ; une autre encore : il allume cette fois son rat de cave.
Sitôt arrivé au rez-de-chaussée, il visite les poches de sa robe de chambre, et compte les bougies qu'il y trouve. Puis va jusqu'à la grande armoire, qu'il ouvre.
Je connais ses trésors : Georges conservait, il y a six mois encore, dans cette armoire, tous les journaux qu'il avait pu trouver — lorsque je lui en demandais un pour faire un paquet, le plus gentiment possible, il ne refusait pas, mais il mettait du temps et de la peine à choisir celui qu'il me donnerait. Les journaux ont été dispersés ; il n'est resté que les lampes à huile de mon père, sa grande lampe à pétrole, une boîte de bougies de Noël. Mais il ouvre, et le rat de cave s'éteint. Puis, c'est la lampe à pétrole qui jette une faible lumière, grésille et meurt. Il referme la porte, et ne songe qu'à partir. Là-dessus une bougie, qu'il vient d'allumer, s'éteint encore. Je suis bien surprise de voir, après un instant de nuit, l'escalier illuminé tout d'un coup et mon père, dont la main est posée sur le bouton de l'électricité.
Alors, sur le palier de l'étage, ce que je prenais pour un paquet s'éloigne lentement. C'est Georges en chemise de nuit, recroquevillé, pieds nus. Il est déjà loin, dans l'ombre, lorsque père atteint la plus haute marche. Et je me trouve effrayée en songeant que j'ai dû voir plus d'une fois déjà, sans chercher à me l'expliquer, ce paquet près de l'escalier, cet homme.
S'il vient ici toutes les nuits, je ne m'étonne pas qu'il soit dur à éveiller le matin.
*
* *
Mais je ne devais comprendre tout à fait ce qui s'était passé cette nuit-là, et qui se passa encore les nuits suivantes, qu'un peu plus tard : ce fut le jour où je surpris Georges, pendant la sieste de mon père, tout occupé à recoller des bouts de bougies dont il avait retiré la mèche ; le rat de cave baignait dans une eau grise. Tout était fait pour rendre les bougies plus incertaines, que l'électricité n'avait jamais pu l'être dans les craintes de mon père.
Il m'arrivait le soir, sur le point de commencer une nouvelle nuit de veille et d'alertes, de me trouver presque soumise à l'idée que les fous, dans leurs refus, prenaient la meilleure part. Mais je sus mieux m'en défendre, lorsque j'eus vu avec quel soin Georges s'efforçait d'éviter à mon père une folie qu'il connaissait mieux que nous.
Plus tard seulement, je pensai qu'il tenait peut-être cette folie pour sa découverte et sa propriété, au point qu'il n'y voulût, par jalousie, tolérer personne d'autre.
Version originale du récit Les Gardiens, parue dans la revue Commerce, Cahier XIX, Printemps 1929