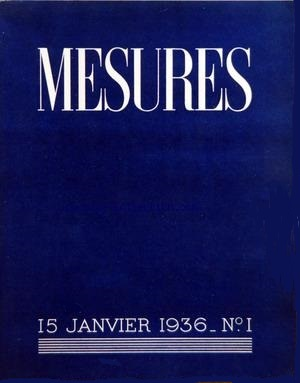
Elements
Jean PaulhanSINGULIÈRES EXIGENCES
Tel écrivain se croit un prêtre, tel autre un homme d'Etat, et le troisième un général. Valère attend des Lettres ce qu'un philosophe n'ose pas toujours espérer de la philosophie : il veut connaître ce que peut l'homme. Et Gille, ce qu'il est.
Il suffirait à Claude de transformer à jamais notre société laïque en un monde sacral. Normand cependant exige le triomphe d'une éthique nouvelle, qui se fonde sur le crime et la merveille. "La poésie, dit-il avec mystère, a pour cela ses moyens". Il semble à Maure suffisant, mais nécessaire, que l'écrivain maintienne au-dessus de l'eau une civilisation qui sombre. Je ne dis rien d'Alerte : la poésie lui paraît chose si grave qu'il a pris le parti de se taire.
Je ne sais s'il est vrai que les hommes de Lettres se soient contentés jadis de distraire d'honnêtes gens. Ils le disaient du moins. (Encore faut-il songer au sens redoutable que peut prendre distraire). Les plus modestes de nous attendent une religion, une morale, et le sens de la vie enfin révélé : il n'est pas une satisfaction de l'esprit que les Lettres ne leur doivent. "Et qui pourrait tolérer, se demande un jeune homme, de n'être pas écrivain ?"
— Quoi, la littérature est donc armée pour traiter de tels problèmes ? — je n'ai pas dit qu'elle les traitait. — Que va-t-elle donc les poser ?
Je n'en sais rien. Il se peut que les hommes soient devenus plus exigeants. Il se peut aussi que les Lettres soient devenues moins donnantes. Tout se passe comme s'il y avait à leur endroit quelque chose de libre, de joyeux et peut-être d'étrange, dont nous aurions perdu jusqu'à l'idée. Ne sachant plus quel est exactement le bienfait qu'elles nous doivent, nous commencerions par tout exiger. (Ainsi l'on réclame en justice dix mille francs pour en obtenir cinquante).
"Mais ce serait le meilleur moyen d'être déçus. — Justement, nous sommes déçus"
A GRAND ESPOIR, GRAND ÉCHEC
N'allez pas cherche trop loin ce qui retient. Audin de s'estimer : c'est le livre qu'il vient d'écrire. Valère n'a pas plus tôt porté sur le poète, ses moyens et son champ de ofrces, un arrêt précis, qu'il s'excuse et paraît gêné. Est-ce lui qui paraît ainsi trancher ? Non, il ne veut empêcher personne ; ses fantaisies valent pour lui seul qui écrit, dit-il, par faiblesse.
"Qu'allez-vous faire, demandait-on à Gille, à présent que votre roman est fini. — Je vais tâcher de l'oublier", dit Gille.
Claude prononce et juge, non sans laisser intervenir Dieu, la nature ou les astres : "Ce livre puant... — Vos critiques, lui dit-on... — Critiques ! Me prenez-vous pour un homme de lettres ?"
Qui attendrait d'Argon une idée juste, ou seulement une idée ? Il distrait, il donne à rêver ; Rostand est gauche près de lui. Mais Argon traite la littérature de machine à crétiniser, et les littérateurs de crabes. S'il n'est pas crabe, l'on ne voit pas ce qui lui reste.
Je parle des meilleurs. Comment leur faire entendre qu'ils écrivent ? C'est du moins, dit Gille, sans le faire exprès. Cependant Broux le romancier s'excuse sur ses personnages qui le pressent, paraît-il, de leur donner la vie. Pour Alerte, il préfèrerait certes user de parfums, de bruits ou d'images que de ces mots déplaisants. Il semble enfin que l'on ne puisse être honnête écrivain, si l'on n'éprouve pour les Lettres du dégoût. Comme il n'était pas de révélation que l'on n'attendît d'elles, il n'est pas de mépris qu'elle ne semble mériter. Et chaque jeune homme se demande avec surprise comment on peut tolérer d'être littérateur.
D'UNE BEAUTÉ DÉÇUE
Il n'arrive pas dans les Lettres beaucoup d'événements de nature à nous enchanter. Ce serait peu, s'il ne semblait que par avance nous nous défendions d'être enchantés. Qui dit d'un poème ou d'un roman qu'il est "bien fait", c'est que l'œuvre ne vaut rien. Il n'est beauté qui tienne, si elle n'a sa faille ou sa lésion.
Restent le caractère et la surprise. Or, ce que la littérature feint de nous donner ainsi, c'est pour le reprendre aussitôt. Ce caractère devient mécanique : cette surprise habituelle, et le contraire d'une surprise. Gourmont observe que toute œuvre personnelle — or, ajoute-t-il, il l'en existe pas d'autre — est condamnée à devenir obscure, si elle échoue ; banale, si elle réussit. Je ne sais si la remarque vaut pour tous les temps ; mais elle vaut singulièrement pour le nôtre, où les Lettres semblent victimes d'une révolte de leur matière : leurs moyens se tournent contre elles, et leur langage les déçoit.
Il semble qu'il suffirait, pour devenir grand écrivain, de ne pas chercher à écrire. Pourtant, si l'on veut découvrir les formules et les procédés à la mode, il les faut demander à ceux qui font profession de fuir la littérature.
Qui cherche à tout prix l'originalité, la perd ; et qui la fuit, la trouve. L'imagination imite, disait Gide, l'esprit critique invente.
Montagne méprise la doctrine ; mais son œuvre dans sa rigidité a l'air d'une rhétorique qui marche. Phèdre se veut tout raison et sagesse ; or ses romans ne prennent sens qu'à partir d'un singulier caprice. L'on disait à Prévost que Guenne quitte la politique pour se donner à l'art : "C'est une grande perte pour l'art", répondit Prévost.
Rien n'arrive enfin dans les Lettres, qui n'arrive à l'envers. L'expérience heureuse, s'il en est une, s'y disperse et demeure sans chemins ni signes.
Botzarro rêva qu'il avait été transporté dans un pays sauvage. Un indigène lui apprit d'affilée tous les noms des animaux et des objets. Cela prit un jour, et Botzarro s'émerveillait déjà de les retenir sans effort. Mais comme il allait parler à son tour : "Non, lui dit-on, chaque mot ne peut servir qu'une fois. Mais recommençons."
Nous habitons ce pays. Mais l'on peut décider d'en sortir.
LE CRITIQUE ET L'ÉLÉPHANT
Qu'il arrive aux critiques de se tromper, l'observation est banale. Mais l'on n'a pas suffisamment remarqué ce qu'il y a dans leurs erreur d'obstiné, de systématique et comme de voulu. Le "siècle de la critique" est celui où tout bon critique méconnaît les grands écrivains de son temps : c'est Fontane ou Planche qui accablent Lamartine ; et Nisard, Victor Hugo. L'on ne peut lire sans honte ce que Sainte-Beuve écrit de Balzac et de Baudelaire ; Brunetière, de Stendhal et Flaubert ; Lemaître, de Verlaine et Mallarmé ; Faguet, de Nerval et de Zola ; Lasserre, de Proust et de Claudel. Tous, il va sans dire, passant sous silence Cros, Rimbaud, Villiers, Lautréamont. Quand Taine veut imposer son romancier, c'est Hector Malot. Ainsi de suite. Et certes, l'on peut juger absurde, en soi la doctrine à la mode qui distingue les créateurs des critiques — ceux-ci tout juste bons à dénouer les cordons des souliers de ceux-là. (Absurde en soi, car enfin la seule différence entre eux réelle, et le seul écart, est au profit du critique. S'il est donné au créateur de parler du rossignol, des pas sur la route, et de l'infini, le critique est libre de parler d'infini, de pas, d'oiseaux — et aussi du poète. S'il appartient au romancier de traiter de l'amour et des mœurs, au critique sont donnés les mœurs et l'amour — et aussi le romancier. En bref, le critique dispose de tous les sujets du créateur, plus un). Absurde, oui. Mais elle a triomphé pourtant, si les critiques depuis cent quarante ans n'ont rien pris tellement à tâche que de ressembler à l'image baroque et déformée, que la Terreur avait formée d'eux. Ils y parviennent assez bien.
L'on a vu de quelle manière ils y parviennent, et par quelles voies. Si le langage critique porte un chiffre à triple secret, et tel qu'humanité, vie et tout aussi bien images ou style signifient, à un premier étage, découvertes dans l'ordre du style ou de l'humanité ; mais, à un second étage, dégagement de tout ce qui peut nous masquer l'humanité et le style authentique ; c'est-à-dire, en fin de compte, les lieux communs et les clichés de style et d'image, d'humanité et de vie : le langage à leur endroit en ce qu'il a de plus banal, de mieux admis — il ne reste enfin à la critique, pour marquer qu'elle se voit placée devant l'œuvre neuve qu'elle ne cessait obscurément de rechercher, qu'une seule ressource : c'est d'avouer son propre désarroi, son incertitude, sa contradiction. Elle se forme un idéal tel qu'elle ne puisse enfin le reconnaître que par son injustice à son endroit, sitôt qu'il est réalisé. L'erreur de Sainte-Beuve ou de Brunetière, de Lemaître ou de Faguetest la seule sorte d'hommage que leur doctrine leur permettait de rendre à Balzac, à Baudelaire, à Nerval, à Zola. Ils n'y ont pas manqué.
Fabre, lorsqu'il a décrit l'application que met le scarabée sacré à malaxer la pilule où il enfermera son œuf, ajoute curieusement que les organes de cet insecte semblaient le destiner à une tout autre activité, et qu'il n'est rien à quoi il s'entende naturellement plus mal qu'à malaxer et à pétrir. "L'idée me vient, dit-il, d'un éléphant qui voudrait faire de la dentelle". Ainsi des critiques. Je veux que chacune de leurs constructions soit ingénieuse et plausible : leur doctrine les ruine à mesure et les mine par le dedans, et ne leur laisse enfin d'autre témoignage, devant l'œuvre authentique, que l'incertitude et la contradiction. Quoi ! Ils l'ont voulu dans leur secret. Ils ont eux-mêmes choisi d'être éléphants.
LA TERREUR TROUVE SON PHILOSOPHE
Il est curieux d'observer à quel point les réflexions de Begson touchant au langage — et à ce langage fragile et toujours recommencé : la littérature — sont devenues vraies. Comme si l'on n'avait attendu qu'elles. Comme si l'on savait enfin avec elles à quoi s'en tenir.
Bergson écrit ainsi :
"Le romancier, déchirant la toile habilement tissée (— tissée par l'intelligence et plus encore par le langage —) de notre moi conventionnel, nous montre sous cette logique apparente une absurdité fondamentale, sous cette juxtaposition d'états simples une pénétration infinie".
J'hésite à reconnaître ici Balzac, Eliot, Tolstoï et les autres romanciers que Bergson pouvait lire. Mais la remarque devient admirablement exacte, sitôt que l'on songe à Proust ou à Joyce.
*
Bergson parle volontiers de l'obstacle qu'opposent au poète les mots, où s'évanouit sans recours l'essentiel de la pensée : cet élément "confus, infiniment mobile, inappréciable, sans raison, délicat et fugitif... que le langage ne saurait saisir sans en fixer la mobilité ni l'adapter à sa forme banale".
Il ne saurait être ici question de Rimbaud, de Baudelaire ou de Mallarmé. L'un porte au langage une confiance magique, le second raisonnée, et le dernier mystique. Bien plutôt y verrait-on l'âme même de la poésie d'un Apollinaire ou d'un Fargue, avec ce désir secret d'humilier le langage — parfois de le recommencer, toujours de valoir mieux que lui.
*
Bergson ne voit, dans la recherche du critique, qu'un effort pour serrer du plus près possible et reproduire en soi "comme un passant se mêle à une danse" l'acte, par lequel le poète ou le romancier "immatériel, distrait, abandonnant tout préjugé de forme, renonçant aux généralités et aux symboles... aperçoit les choses dans leur réalité originelle."
Non, ce n'est pas là Sainte-Beuve, Brunetière, ni Faguet. Mais j'y reconnais Thibaudet, pour qui "l'idéal du critique est de coïncider avec l'esprit créateur du romancier". Ou bien Charles du Bos, tout occupé d'éviter "l'inconscient besoin de symétrie qui viendrait, en cristallisant les formes si fluides de la vie spirituelles, séparer le critique du créateur qu'il suit à la trace..."
... et la critique enfin tout entière, dont on a saisi le secret. Comme si la Terreur — qui trouve du premier jour son manœuvre, Sainte-Beuve ; un peu plus tard son doctrinaire, Taine ; puis ses érudits, ses collectionneurs, ses hommes du monde : Faguet, Schwob, Lemaître ; ses grands inquisiteurs, Brunetière, Gourmont — avait attendu jusque vers 1900 son philosophe, Bergson.
LE DUC DE BRÉCÉ LIT DES ROMANS-DÉTECTIVE
Chacun sait qu'il y a, de nos jours, deux littératures : la mauvaise, qui est proprement illisible, et la bonne, qui ne se lit pas. C'est ce que l'on a appelé (entre autres noms) le divorce de l'écrivain et du public.
La Bibliothèque des ducs de Brécé, qui avait accueilli tous les grands livres du xviiie siècle, ne reçut de 1800 à 1850 que Chateaubriand, Guizot, Marchangy. Après 1850, deux ou trois brochures relatives à Pie XI et un panégyrique de Jeanne d'Arc. C'était peu. Charles Maurras explique là-dessus que la faute n'en est pas aux Brécé, mais au seul écrivain ; à ses déclarations anarchiques comme à ses cryptogrammes abstrus, où la bonne Société ne trouve rien qui l'attache ou l'intéresse : rien qu'elle se doive d'encourager.
Il se peut. Et pourtant je ne vois guère d'énigme ou de cryptogramme — et fût-il anarchique ou révolutionnaire — qui ne reçoive d'abord l'adhésion de la meilleure société. Les revues difficiles paraissent sur papier de luxe ; ce qui se lit sur papier chandelle est toujours sage et très clair. Et les duc de Brécé sont célèbres de nos jours pour leur collections de manuscrits de Sade et d'invectives surréalistes. Je crois qu'il faut chercher ailleurs la raison d'un divorce,
dont l'autre face est celle-ci : l'on voit curieusement triompher de nos jours, et couvrir la terre, le seul genre qui obéisse à des règles plus strictes que la tragédie de Voltaire ou l'ode de Malherbe. Je veux dire cette sorte de roman qui s'interdit dans l'ordre des états d'âme, le rêve, la rêverie, les pressentiments, l'analyse psychologique ; dans les personnages, lemétaphysicien, l'occultiste, le membre de société secrète, le grand voyageur, l'hindou, le chinois, le malais ; sur le plande la sensibilité, le pittoresque, le baroque, l'excessif ; de l'intelligence, les mythes, les symboles, les allusions — et suit, dans son progrès, un ordre rigoureux au point de présenter, dès le premier chapitre, tous les éléments — personnages, lieux, objets — d'un problème, qui ne sera pas résolu avant les dernières pages.
L'on admet volontiers, quand il s'agit d'expliquer le succès du roman-détective, (et les démocrates tout les premiers, j'ai regret de la dire) que le public est bête, et se contente de pas grand'chose : de quelques meurtres, d'un style grossier, d'une psychologie élémentaire. Mais je me demanderais volontiers s'il n'est pas subtil au point d'éprouver — à défaut des les comprendre — l'effet des divers traits et des arguments que peut découvrir, à la gloire de la rhétorique, une analyse têtue. En bref, s'il n'aime pas le roman-détective pour ce qui fait le caractère seentiel du roman-détective.
Voici que l'on pourrait dire à l'appui de cette hypothèse (que je risque timidement). C'est d'abord que le roman-détective, s'il était bien écrit, ne se vendrait sans doute pas moins ; ni le roman littéraire davantage, s'il était mal écrit. Puis, il n'est pas invraisemblable, si les liens et les liaisons de le rhétorique ont pour effet de nous porter jusqu'à une nature particulière de la pensée, qu'un instinct, une intuition, nous avertisse (sans nous permettre de l'exprimer) de la présence de cette nature — et d'autant plus sûrement qu'il s'agit en effet de ce qui échappe, par nature, au langage, à la réflexion.
L'on me dira que l'expérience a déjà été faite. Mais je me demande si elle n'est pas viciée, le plus souvent, par une erreur de principe. En fait, il demeure, dans les romans-détectives écrits "à la littéraire", je ne sais quelle condescendance qui n'humilie pas moins le lecteur que l'auteur. Le cœur, comme on dit, n'y est pas. C'est comme si l'on avait visé au succès du roman-détective plutôt qu'à sa raison. Mais qui fixerait au contraire cette raison, il n'en faudrait sans doute pas plus pour étendre aux Lettres tout entières l'ébauche de réconciliation, que nous tend le roman-détective.
*
* *
PETIT INCIDENT DE LANGAGE DANS LA FAMILLE LANGELON
Une cousine des Langelon s'en alla passer quinze ans de sa vie au Canada. Quand elle revint, on découvrit qu'elle parlait en proverbes, et avait la rage de dire à tout propos “A bon entendeur salut”, ou “Faute d'un point...”. Il y avait aussi certaine façon solennelle de prononcer “hystérie”, ou “mauvais symptôme”, qui mit la famille en joie. Les Langelon, petits et grands, prirent l'habitude de dire, en plaisantant : “Faute d'un point, comme la cousine Henriette” ; ou encore : “Mauvais symptôme, mauvais symptôme” en hochant un peu la tête. Cela prenait bien des sens : on le disait d'une personne sentencieuse et compassée, on le disait aussi (non sans ironie) à propos d'une déception : “Comme dit Henriette...” (le reste allant de soi). Il se passa, quelques années plus tard, un événement curieux.
C'est que les amis et les voisins des Langelon s'aperçurent, à leur surprise, que les Langelon — qui avaient toujours raillé les phrases banales — s'étaient mis à leur tour à parler en proverbes, disant à tout bout de champ : “Comme Henriette...” ou “Faute d'un point...” Les sages rappelèrent qu'Henry Monnier était devenu une sorte de Joseph Prudhomme ; Alfred Jarry, un Père Ubu. Les imprudents firent un nouveau proverbe qui commençait par : “Comme un Langelon...” Il est vraisemblable qu'ils furent pris à leur tour. Et, si l'on y songe un peu, la mésaventure des Langelon était inévitable.
Car leur premier étonnement, n'ayant guère l'habitude des proverbes, tenait de leur propre aveu à ce qu'Henriette sortit à tout bout de champ son “bon entendeur” et son “symptôme” — Cela faisait (disaient-ils) maniaque, automatique, elle répétait tout le temps les mêmes phrases. Or, les répétant à leur tour, et fût-ce avec ironie, à propos des événements les plus dissemblables, ils ne prenaient pas garde qu'elles devenaient insensiblement les noms de ces événements. D'où l'écart de sens et l'ironie s'effaçaient peu à peu. Et certes leur “symptôme” n'était pas tout à fait celui de la cousine Henriette : il était moins sérieux, et l'on eût pu l'appeler plus exactement, la plupart du temps, apparence ou faux symptôme. (C'est ainsi que je les ai entendus parler, à la promenade, d'un nuage, trop léger pour amener la pluie ; à la maison, de deux couteaux mis en croix — mais ils n'étaient pas superstitieux.) Peu importe : dès l'instant que le “symptôme” désignait régulièrement l'apparence ou l'illusion, il en devenait le nom sans plus aucune ironie.
La cousine Henriette reconnut plus tard qu'à elle aussi les proverbes n'avaient été d'abord, au Canada, qu'ironie et que défense. Ainsi Flaubert dresse patiemment la liste des “idées reçues” qu'il faut éviter, et puis en compose ses livres — son langage. Timidement d'abord, dans Madame Bovary ; sans plus aucune réserve, dans Bouvard et Pécuchet (et l'on sait à quel point Flaubert était lui-même devenu Bouvard). Ainsi encore, Moréas pourchasse patiemment les lieux-communs jusqu'au point que la persécution les lui rend renouvelés... Mais c'est pousser trop loin le proverbe des Langelon.
MÉTAMORPHOSE DE LA RHÉTORIQUE
Une part de la science des médecins consiste à rendre par artifice aux malades le phosphore ou la chaux que ceux-ci ont dépensés en trop — et recomposer ainsi un homme normal. Ainsi des rhétoriqueurs, dont le plus sage que l'on puisse dire est qu'en restituant à notre pensée la part de liens et de liaisons, dont le regard la prive, ils reforment par artifice une pensée authentique, avant conscience. Si le regret d'Olympio, si le désir de Phèdre ou l'argument d'Athalie ressemblent un peu plus à nos passions et à nos arguments véritables que l'image déformée que nous en prenons, c'est grâce aux rimes, à l'unité de temps et de lieu, au dilemme. Il n'est pas ici de combinaison abstraite, si arbitraire soit-elle, qui ne nous approche d'une vérité — dont rien ne nous écarte davantage que le regard spontané, la prise de conscience. Qui veut se connaître, qu'il ouvre un livre.
Je n'ai pas dit que la rhétorique fût le moins du monde d'un maniement aisé, ou naturel. Et bien au contraire est-il sensible que son emploi — et son maintien plus encore — vont rencontrer de sérieuses difficultés.
Car les rhétoriques ne nous mentent pas tout à fait, sans doute, quand elles nous promettent l'accession au plus pur de l'esprit. Encore faut-il observer que, cet esprit, elles ne l'atteignent pas directement, mais de biais et suivant une marche oblique. Disons mieux : par illusion. Le procédé de la rhétorique, tel qu'on l'a analysé, consiste à nous jeter dans un embarras de langage tel que force nous soit de nous raccrocher à la pensée. L'on songe à d'autres ruses de même ordre. L'enfant, à qui sa mère commande d'aller acheter du pain, peut, s'il parvient à obtenir de son père l'ordre de ne pas bouger de la maison, se retrouver aussi libre qu'il l'était tout à l'heure de sortir ou de rester : il n'a plus affaire qu'à ses préférences. Ainsi le lecteur, qui hésite s'il se bute à une phrase arrangée de neuf et combinée pour la circonstance, ou tout au contraire naïve et spontanée, se trouve libre, à la rencontre de ces deux ordres, dans l'appréhension d'un sens qui, lui du moins, n'a pas varié.
Qui voudrait, en ce sens, compléter la rhétorique, se verrait assez vite contraint à compliquer et multiplier à l'infini les ordres de phrases possibles ; à provoquer sans cesse à leur sujet de nouveaux doutes (puisque ce doute est la condition même de l'accession à l'idée) ; à varier indéfiniment leur forme, ou mieux à réduire cette forme à l'expression la plus abstraite qu'il se pourra ; en bref à ne présenter aucun lieu-commun qui ne soit susceptible de mille phrases diverses.
Je ne dis rien que l'expérience ne vérifie. Tandis que la Terreur, qui les condamne, étale avec complaisance ses listes de lieux-communs (de l'ambiance capiteuse à la perversité précoce), la rhétorique, qui les loue, dissimule si bien les siens qu'on les croirait perdus. Les définitions mêmes, qu'elle en donne, sont gagnées à cette dissimulation, à ce vague. Le lieu, dit Vico, est tout élément du discours, et comme les lettres dont il est composé. Tout phénomène de l'idée, dit Aristote. Entendons qu'il n'est rien qui ne soit lieu-commun : modes de raisonnement, procédés d'exposition, images, tropes, règles, et jusqu'au moindre sentiment qui vient à l'esprit d'un auteur, tout y passe — dès l'instant que l'on évite la formule et la phrase stéréotypée qui, elle, ne pourrait obtenir le singulier bénéfice du doute. Mais qui ne voit, dès lors, que la rhétorique est susceptible d'un progrès.
Il y suffirait qu'elle avouât franchement son propos véritable : et bornât son effort à proscrire les formules, les images banales, les règles trop évidentes et sur lesquelles aucun doute n'est possible. Qu'elle exigeât enfin la différence et l'originalité — non pas de l'œuvre seule, mais de l'auteur, qui commande l'œuvre. Ou bien encore la distraction et l'absence de cet auteur (afin que les clichés s'il en est encore — et qui se ferait fort de les éviter tous ? — pussent du moins prêter au doute). Poussant plus loin — pourquoi pas ? — elle pourra tout aussi bien dresser, devant cet auteur, le mythe redoutable d'un langage envahissant. Mais l'on a assez vu que la rhétorique, sitôt qu'on l'a séparée de sa légende, et rendue à son exigence véritable, n'a d'autre ressource que de se poursuivre en Terreur.
UN SPECTATEUR SUFFIT A CHANGER LE SPECTACLE
Il est à peu près admis que nous pouvons regarder, sans que notre regard y vienne altérer quoi que ce soit, les événements qui nous entourent et nous accompagnent : un objet qui tombe, un arbre qui prend feu, une eau qui bout. La science est à ce prix, et l'on sait quelles difficultés l'attendent sitôt qu'elle veut mener ses enquêtes à l'échelle où le spectateur — et la seule lumière dont il s'éclaire — change par sa présence le spectacle. (C'est ainsi que l'électron voit sa position ou sa vitesse altérée par le photon lumineux que met en jeu, pour le saisir, l'observateur.) Mais il est au contraire des objets que le regard aussitôt modifie, et des spectacles qui ne supportent pas le spectateur.
Ce sont les mots.
La chose se passe à l'endroit de je ne sais quelle hantise. Qui de nous ne s'est essayé à regarder longuement, patiemment, et jusqu'à la faire un peu bouger (espérait-il) une boule de coton, une boîte d'allumettes ? Qui de nous n'a essayé un jour de faire pleuvoir, d'appeler le soleil, par la seule force de son regard ? Cela ne s'avoue pas toujours, je le sais bien. Mettons que c'était dans l'enfance. Mais cela laisse du moins des souvenirs et des traces.
*
L'on sait bien qu'il suffit de faire attention à un mot, de le répéter, de le poursuivre, pour le transformer : et tantôt jusqu'à en perdre le sens, et ne plus tenir sous nos yeux que des sons absurdes et privés de raison. Mais tantôt aussi, le plus souvent, jusqu'à obtenir d'autres mots, tantôt voisins du premier et tantôt très différents, qui s'élèvent de cette ruine. Salaire peut me conduire jusqu'à marais salants, à salé, à sel, à sale. Cimetière me mène à cimeterre, à cime, à terre. Mais un mot plus simple, sel ou sable, peut fort bien se décomposer seulement, n'évoque plus rien qui vaille, se perd dans les sables.
*
La science, le sérieux, la méthode interviennent ici. Elles décrètent que l'évocation est tantôt légale, et tantôt détestable. Il se peut bien — et que sel (qui est, dit-on, “étymologie”) soit hautement recommandable, mais sale (qui est “jeu de mots”) absurde. Mais les partis-pris de la science ne sont pas les nôtres. Que s'il s'agit du sens actuel de salaire, il n'a guère plus de liens avec sel qu'avec sale, et un professeur, M. Bally, a pu écrire un excellent ouvrage dont tout le propos est d'établir que la recherche étymologique trompe l'élève sur le sens et l'usage des mots qu'il apprend (1). Au surplus, c'est exactement suivant la même démarche et par la même voie que l'attention portée sur le mot nous fait découvrir l'un et l'autre.
Le point curieux serait plutôt dans l'espoir que fait naître en nous, naturellement, la recherche étymologique. Il est tout indiqué d'admettre (je cite les savants) qu'elle nous révèle — ou du moins nous doit un jour révéler — le passé de l'homme et du monde, notre propre histoire, le sens originel des mots...
Il se peut encore. Je n'en sais rien. Libre à chacun d'attendre de telles révélations — où je retrouve du moins le trouble et l'espoir qu'éveillait en nous cette cause de l'étymologie (comme du calembour) : l'effet de notre attention, et d'un regard sur les mots un peu prolongé.
*
Il reste que cet effet singulier prête à d'infinies variations : tantôt absurde et tantôt révélateur. Tantôt qui nous saute aux yeux ; et tantôt presque effacé, qui se disperse et s'évanouit. Le plus insaisissable enfin qui soit. Sauf...
Il est tout un ordre de mots — et l'on imagine aussitôt de quel prix ils nous devraient être — où cet effet incertain, capricieux, insaisissable, se trouve constant, et comme codifié. Où le calembour et l'étymologie se confondent ; où notre regard et notre attention ne produisent qu'un effet — en sorte que cet effet y devienne clair, attendu — mais notre regard aussi parfaitement régulier, aisé à saisir, aisé à connaître.
C'est le lieu-commun. On voit bien qu'il est différent de dire négligemment point-du-jour, carte blanche, volupté-meurtrière, et de les dire avec attention. C'est d'abord qu'ils sont simples à qui les dit comme d'autres mots, et complexes au contraire à qui se regarde les dire : ici, de véritables phrases, avec leurs liens, leur détail, leurs réflexions et leurs métaphores et là de simples mots, d'apparence indécomposable. Mais il y a plus.
C'est que la négligence nous donne un fait, et la réflexion l'origine de ce fait. Si “je vous donne carte blanche” a un sens simple, c'est qu'il y a eu pour commencer une carte, et qui était blanche. Si Pas-perdus est le nom d'une salle, c'est que l'on y a d'abord perdu ses pas. En bref, le lieu-commun est le point du langage où l'attention que nous portons aux mots exerce un effet sur eux régulier, constant — où cette attention peut donc se voir déterminée à partir de cet effet, définie par cet effet. Où nous savons enfin ce que porte avec soi un regard lourd de conséquences.
C'est d'où vient sans doute que toute recherche, qui a trait à l'expression, s'en prenne (le plus justement du monde) au lieu-commun. Il est un langage en raccourci ; un langage, et le regard que nous portons sur lui.
1 - Ici l'on devrait noter que l'étymologie change : les explications de Platon nous paraissent aujourd'hui absurdes. Et celles même que l'on donnait, il y a cinquante ans, des mots français les plus courants. L'étymologie ne cesse guère, dans l'histoire, de passer calembour. Et l'inverse.↩
Texte paru dans la revue Mesures, 15 octobre 1938 - N°4.